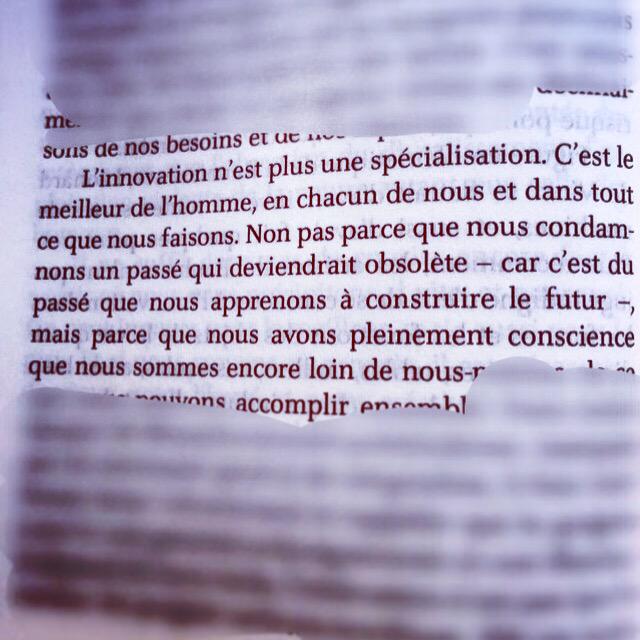tweet art: manichéismes, 2016
"Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre
nous" dixit un président américain irresponsable et inintelligent après le
11 septembre. Ceux qui ne sont pas des combattants farouches du prophète,
fussent-ils musulmans, ne sont que de vulgaires mécréants affirment les
djihadistes de Daesh. Et ils tuent sans merci. Ils sont binaires,
fondamentalistes, fanatiques, stupidement binaires.
Ce mode de pensée simpliste, si dangereux, est
terriblement répandu et contagieux, de nos jours comme toujours.
Il a été la clé de voute du manichéisme, une religion
fondée par un prophète prêcheur du IIIe siècle nommé Mani qui divisait le
cosmos entre deux puissances, les Ténèbres, l'empire de Satan, et la Lumière,
le monde de Dieu, engagés depuis toujours dans un combat à finir, mais sans
issue possible, puisque Satan y est l'égal de Dieu. L'homme lui-même est pris
dans cette lutte, selon Mani, puisque son corps appartient aux Ténèbres et son
esprit à la Lumière.
Mani est l'exemple même d'un créateur de mythe. Car il
imagina, conceptualisa, écrivit et prêcha un récit des origines du monde
impliquant une conception de l'homme et une religion en s'inspirant des
diverses croyances de l'époque et notamment du zoroastrisme, du christianisme
et du bouddhisme. Le manichéisme se répandit largement avec l'appui du du
pouvoir politique du monarque sassanide Shapur 1er, soucieux d'unir son peuple
sous une religion identitaire. Il était lui-même très instruit, fils de famille
princière. Mani prétendit avoir eu de nombreuses visions d'origine divine et il
mourut supplicié. Son martyr ajouta à la puissance du mythe qu'il
créa.
Le mythe manichéen devint donc une religion
puissante. Saint-Augustin lui-même fut manichéiste avant de se convertir
au christianisme et de prêcher contre la théologie de Mani.
Comme tous les mythes, il puise dans des récits
antérieurs connus de son auteur. On trouve déjà dans presque toutes le
religions l'opposition entre la lumière et le ténèbres. Ainsi, selon l'Ancien
testament (chapitre 1),
"Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide: il y
avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière
fut. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec
les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les
ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier
jour." Pour le bouddhisme, le nirvana
conduit à se fondre dans la lumière. Et le dualisme qui identifie le bien à la
lumière et le mal aux ténèbres se trouve déjà dans le zoroastrisme (prêché par
Zharathoustra), lui-même issu du mazdéisme et qui remonte au 4e millénaire
avant J. C. Le zoroastrisme fut la religion officielle de l'empire perse à
plusieurs reprises et notamment sous les Sassanides. Mali en connaissait donc
bien les termes. Le manichéisme fut donc très
rigoureux dans sa théologie comme dans ses règles de vie et de pratique. Il
était d'inspiration pacifiste, mais il ne se maintint pas longtemps comme
religion, car il fit partout l'objet de multiples persécutions, tant au
Moyen-Orient que dans l'empire romain. Mais grâce à
son syncrétisme simplificateur - il se voulait une religion
universelle - son influence demeura longtemps présente, à travers le
christianisme, le bouddhisme et les diverses religions du Moyen-Orient, tant
dans l'empire perse, que dans le monde arabe, en Europe dans l'Empire romain
jusqu'en Gaule, en Afrique romaine et en Asie jusque dans la Chine des Tang et
au Japon. Et nous en retrouvons aujourd'hui encore l'influence évidente dans
l'islam, notamment dans le jeûne rigoureux du ramadan, dans le binarisme
impitoyable de la charria, dans ses intolérances et les luttes fratricides
entre ses diverses interprétations sunnite, chiite, salafiste, wahabiste,
soufiste, etc., dont le chefs religieux ne cessent de s'affronter comme le font
Dieu et Satan dans la doctrine manichéiste, sans jamais venir à bout les uns
des autres. Nous retrouvons dans l'islam fondamentaliste cette opposition
manichéenne entre "les fils de la Lumière" et "les fils des
Ténèbres", dont l'interprétation guerrière du Coran inspire le djihad contre tous les mécréants, islamistes pacifistes et croyants d'autres
religions confondus.Tuer les mécréants des Ténèbres ou
devenir martyr en se faisant exploser pour accéder à la Lumière de Dieu, voilà
l'interprétation manichéenne prêchée par Daesh.
Et bien plus généralement que ce manichéisme qui fait des ravages dans l'intégrisme islamique actuel, nous observons son origine psychique dans le comportement ordinaire, binaire, si répandu, si structurel de l'esprit humain, qui simplifie abusivement la complexité des idées, qui nourrit "la peur de l'autre", notamment dans tous les fascismes, mais aussi dans les populismes actuels qui sévissent de plus en plus dans les pays européens, dans toutes les haines partisanes ou personnelles qui empoisonnent la vie sociale.
Cette logique binaire, celle de Port-Royal, janséniste, qui fonde le rationalisme classique lui-même issu de la théologie, qui impose le "tiers exclu", est un mode de pensée fort répandu et qui semble éternel et universel. Il nourrit l'instinct de puissance et Thanatos. Il y a du manichéisme en chacun de nous. A est différent de B, C est exclu de A et B. Le code binaire fondateur de l'informatique en relève tout autant. 1 ou 0, On ou Off. Le transistor laisse passer la lumière (le courant électrique) ou la bloque. Toute tierce option est exclue. Et cela donne à l'informatique toute sa puissance de calcul, un pouvoir inédit.
Pourtant la mécanique quantique resurgit de cette forteresse rationaliste et revendique aujourd'hui l'instabilité de l'opposition entre A et B. Une particule peut être tantôt A, tantôt B, voire simultanément les deux. Le système craque sous la pression de la réalité, qui est beaucoup plus complexe que le binarisme.Et le conformisme du binarisme sexuel lui-même est remis en question. La société tolère de moins en moins mal les comportements homosexuels ou transsexuels, les revendications transgenres, l'hermaphrodisme.
Le manichéisme est d'origine instinctive, animale. Il vient de la lutte pour la survie, pour le territoire, qui considère l'autre animal, l'autre clan, l'autre ethnie, l'autre religion, l'autre culture comme un compétiteur, un ennemi à chasser, à éliminer. Il faut ici parler d'un manichéisme ordinaire, qui est présent dans nos comportements, dans nos sociétés, et avec lequel nous apprenons à composer plus ou moins bien selon les situations sociales, les pressions démographiques, les tensions économiques. Et lorsque ce manichéisme instinctif est exacerbé par des volontés de pouvoir, il prend dimension mythique et se transforme en cosmogonie, en théologie, qui peut alors fonder des religions et susciter des intégrismes violents, barbares, tels ceux des guerres de religions en Europe encore récemment ou de Daesh aujourd'hui. Aucune négociation ne semble alors possible entre la Lumière et les Ténèbres, entre le Bien et le Mal. On ne vise plus que l'extermination. Nous observons aujourd'hui même les effets épouvantables de cette exacerbation radicale du manichéisme ordinaire.
Et bien plus généralement que ce manichéisme qui fait des ravages dans l'intégrisme islamique actuel, nous observons son origine psychique dans le comportement ordinaire, binaire, si répandu, si structurel de l'esprit humain, qui simplifie abusivement la complexité des idées, qui nourrit "la peur de l'autre", notamment dans tous les fascismes, mais aussi dans les populismes actuels qui sévissent de plus en plus dans les pays européens, dans toutes les haines partisanes ou personnelles qui empoisonnent la vie sociale.
Cette logique binaire, celle de Port-Royal, janséniste, qui fonde le rationalisme classique lui-même issu de la théologie, qui impose le "tiers exclu", est un mode de pensée fort répandu et qui semble éternel et universel. Il nourrit l'instinct de puissance et Thanatos. Il y a du manichéisme en chacun de nous. A est différent de B, C est exclu de A et B. Le code binaire fondateur de l'informatique en relève tout autant. 1 ou 0, On ou Off. Le transistor laisse passer la lumière (le courant électrique) ou la bloque. Toute tierce option est exclue. Et cela donne à l'informatique toute sa puissance de calcul, un pouvoir inédit.
Pourtant la mécanique quantique resurgit de cette forteresse rationaliste et revendique aujourd'hui l'instabilité de l'opposition entre A et B. Une particule peut être tantôt A, tantôt B, voire simultanément les deux. Le système craque sous la pression de la réalité, qui est beaucoup plus complexe que le binarisme.Et le conformisme du binarisme sexuel lui-même est remis en question. La société tolère de moins en moins mal les comportements homosexuels ou transsexuels, les revendications transgenres, l'hermaphrodisme.
Le manichéisme est d'origine instinctive, animale. Il vient de la lutte pour la survie, pour le territoire, qui considère l'autre animal, l'autre clan, l'autre ethnie, l'autre religion, l'autre culture comme un compétiteur, un ennemi à chasser, à éliminer. Il faut ici parler d'un manichéisme ordinaire, qui est présent dans nos comportements, dans nos sociétés, et avec lequel nous apprenons à composer plus ou moins bien selon les situations sociales, les pressions démographiques, les tensions économiques. Et lorsque ce manichéisme instinctif est exacerbé par des volontés de pouvoir, il prend dimension mythique et se transforme en cosmogonie, en théologie, qui peut alors fonder des religions et susciter des intégrismes violents, barbares, tels ceux des guerres de religions en Europe encore récemment ou de Daesh aujourd'hui. Aucune négociation ne semble alors possible entre la Lumière et les Ténèbres, entre le Bien et le Mal. On ne vise plus que l'extermination. Nous observons aujourd'hui même les effets épouvantables de cette exacerbation radicale du manichéisme ordinaire.