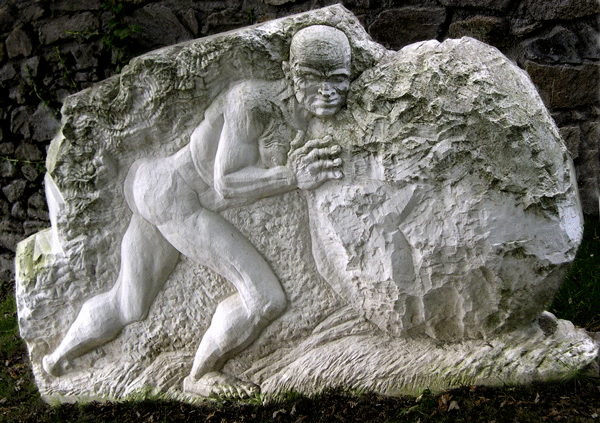La mythanalyse exige une complexité conceptuelle et une durée incompatibles avec la vitesse du numérique. Mais des icônes mythanalytiques peuvent se concevoir, qui ciblent les grands mythes et nous rappellent leur pouvoir sur les réseaux numériques. Ils peuvent provoquer, questionner l'imaginaire social jusque dans son inconscient. Les oiseaux aussi célèbrent de grands mythes. Les représentations d'oiseaux semblent rares dans les peintures préhistoriques, encore qu'on trouve un homme à tête d'oiseau à Lascaux. Mais ils jouent un rôle essentiel déjà dans les symboliques de l'Égypte ancienne, de la Chine, du Japon. Dans la mythologie biblique, le saint-esprit apparaît sous forme de colombe. Dans la mythologie grecque, c'est Zeus lui-même qui se métamorphose en cygne pour séduire Léda.
Les oiseaux numériques symbolisent-ils l'esprit humain, la spiritualité, l'élévation virtuelle?
Tuit! Tweet! Faut-il y lire la célébration de la vie, du soleil, de l'air virtuel? Un gazouillis pacifiste? La migration planétaire de notre civilisation? Même si nos oiseaux tweeters sont souvent les premiers messagers des mauvaises nouvelles autant que des bonnes, comment nier l'euphorie joyeuse des Tuit! Tweet! annonciateurs du printemps ou de l'amour? Les tuit peuvent être de grands messagers mythanalytiques.
Hervé Fischer
tout ce qui est réel est fabulatoire, tout ce qui est fabulatoire est réel, mais il faut savoir choisir ses fabulations et éviter les hallucinations.
lundi, mars 28, 2011
samedi, mars 26, 2011
le péché originel
La pomme du paradis terrestre? Le péché originel: un diabolique ver de terre dedans, qui fait encore crier les femmes aujourd'hui. À juste titre: une bombe à retardement. Le propre de la tragédie est de finir mal. Dès le début de la vie, on se sait condamné à mort. Il ne reste plus qu'à choisir entre la tragédie ou rien. Faut-il plutôt se jouer la comédie? Ou en faire un drame? Dans tous les cas, l'oubli final est assuré. La mort ou rien. À moins de se prendre pour une poussière d'étoile dans l'éternité de l'univers. Oublier la Bible. Opter pour l'athéisme: la tragédie devient joyeuse.
hf
hf
vendredi, janvier 21, 2011
Mythanalyse de Dieu
Voici un bref extrait du chapitre que j’ai consacré à ce thème, qu’on pourra lire intégralement dans « Heureux sans Dieu », un livre collectif publié aux éditions Multimondes, Québec, 2010
Peut-on aller plus loin que les interprétations sociopolitiques du rôle des religions et des Églises, pour expliquer au niveau non seulement institutionnel et civil, mais aussi psychologique la puissance d’un dieu qui s’incruste manifestement dans les esprits individuels? Je parle ici d’un dieu intériorisé, avec lequel les croyants croient pouvoir entrer en relation intime. Faudrait-il invoquer une dimension biologique de la société? Et reprenant la notion de solidarité organique de Durkheim, faudrait-il reprendre des arguments génétiques de la sociobiologie de Wilson? Alors pourquoi les hordes de singes ou d’éléphants n’ont elles pas de dieu, ni de religion qu’on puisse observer? Elles ont cependant un vieux mâle dominant, qui est le sage de service. Il est respecté et obtient comme tel l’obéissance de tous. Dieu serait-il notre vieux singe? En tout cas, dans nos religions humaines, il se présente bien comme un aïeul chenu, empli de sagesse et à qui nous devons obéissance. Notre Père qui êtes aux cieux, donnez nous notre pain quotidien... dit le Pater Noster catholique.
L’hypothèse de la mythanalyse, c’est que la figure du dieu, le dieu unique, est l’hypostase symbolique du père biologique sur laquelle se base la cellule familiale. En ce sens, il est l’expression collective du mythe familial élémentaire que la mythanalyse considère comme le fondement biosociologique de tous les mythes. Le nouveau-né en est entièrement dépendant, comme l’adulte pieux l’est de son dieu. Le mythe de dieu incarne manifestement et valorise dans une célébration collective l’image du père, symbole de la force créatrice et de l’autorité dans le cercle familial, qui est la matrice et le reflet tout à la fois de la société. Autrement dit, ce dieu synthétise au niveau social l’image du père géniteur et garant de la matrice familiale et sociale dans sa conception patriarcale. Le mythe de dieu est celui même de la création, c’est-à-dire le reflet grandi et socialement institué du pouvoir géniteur du père, célébré par ses enfants.
Ce désir fusionnel avec un dieu puise sa force dans le mythe de l’unité, que nous nous employons obsessionnellement à retrouver. L’âme tend à s’unir à dieu. Cette tension est bien sûr primitive, au sens où elle met en jeu les figures de l’origine et de la création. La première unité perdue de l’être humain est évidemment toujours fœtale. C’est celle de l’appartenance originelle au corps parental, qui constitue la matrice biologique du mythe élémentaire. Et la séparation, lorsque le cordon ombilical est coupé, créera une durable nostalgie organique et psychique. Le rapport au père n’est pas moins biologique, même s’il trouve son expression sociale davantage à un niveau symbolique. Et ce mythe élémentaire de l’unité perdue est déterminant dans l’image du monde qu’imagine chaque enfant. Il perdure et suscite encore chez l’adulte de fortes représentations compensatrices qui détermineront ses comportements et ses désirs fondamentaux. Nous en observons l’effet puissant dans une déclinaison de mythes secondaires, qui varient selon les sociétés, les époques, les cultures, et donc les religions. Nous le transposons par exemple dans notre nostalgie vis-à-vis de la Nature panthéiste, ou dans l’invention biblique du paradis terrestre et du lien fusionnel avec un Dieu qui nous en a chassé, ou dans notre intégration au corps social au sein d’une communauté familiale, religieuse, politique, d’une bande, d’un club, etc., ou plus universellement dans le désir amoureux
La mythanalyse suggère aussi une deuxième fonction du mythe de dieu. N’oublions pas que la relation entre l’homme et le mythe de dieu est contradictoire. Il existe une sorte de tension dans le mythe biblique qui est très efficace, comme un piège pour la psyché humaine. En effet, d’une part la Bible soumet l’homme à la culpabilité insurmontable du péché originel et le condamne à une vallée de misère où il rachète son salut par la souffrance; et d’autre part, elle dit que l’homme est à l’image de dieu, et même qu’il en possède en lui une parcelle – l’âme –qui rejoindra le dieu dans l’au-delà. Comment ne pas y voir une projection du désir de puissance de l’homme? Certes, le fils aspire à prendre la place du père. Mais adorer ce dieu, c’est pour l’homme s’adorer soi-même et se célébrer sous la figure la plus parfaite de ce que l’homme voudrait être, au point de se flageller et de renier la version simplement terrestre de ce qu’il est, enfermé dans les limites de ce corps matériel qu’il voudrait transcender. Dans son imaginaire, l’homme s’attribue à lui-même un statut divin, qui le distingue des autres animaux. La croyance en ce dieu le valorise considérablement. Ce dieu est une sorte de projection que l’homme se propose de lui-même sous la forme d’une omnipotence, d’une sagesse et d’un pouvoir créatif qu’il ne peut manquer de désirer, précisément parce qu’il en est privé. Cet aspect prométhéen du mythe biblique est d’origine grecque. L’homme affronte même le dieu pour lui voler le feu et rivaliser avec lui. Nous retrouvons ici Prométhée, et l’instinct de puissance *.
Ce lien que l’on partage avec le dieu, peut prendre une intensité extrême, comme en témoigne l’expérience du mystique qui atteint l’extase, du fou de dieu qui échange son martyre contre « le paradis ce soir avec une vierge », du Cathare qui se jette avec exaltation dans le feu purificateur qui est la métaphore de dieu lui-même. C’est la béquille des nouveaux évangélistes et de tous ces intégristes qui, n’étant pas capables d’assumer pleinement leur humanité, se réfugient dans la soumission à un maître absolu pour vociférer leurs condamnations. Une façon de croire se grandir soi-même, alors qu’ils tombent au comble de la débilité.
Les dieux et les âmes sont des drogues, des psychotropes qui exaltent l’esprit, qui nous donnent l’illusion de n’être pas des animaux, mais des êtres qui participent au divin, et qui nous détournent de la réalité quotidienne lorsqu’elle est frustrante ou douloureuse.
------------------------------
•CyberProméthée, vlb, Montréal, 2003
lundi, janvier 10, 2011
Centre d'étude sur l'actuel et le quotidien
le CeaQ vous annonce les prochaines soutenances de thèses à ne pas manquer:
12 janvier 2011 à 14h : Manuel BELLO: Des illuminations profanes. Une étude sur les formes de la perception urbaine contemporaine.
Jury : Michel Maffesoli (Sorbonne), Marc Perelman (Paris Ouest), Olivier Sirost (Rouen), Chris Younès (École spéciale d'architecture Paris), Amphi Durkheim, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
21 janvier 2011 à 10h : YiBing XU : La pensée primitive, Internet et la mort.
Jury : Michel Maffesoli (Sorbonne), Jean-Martin Rabot (Braga), Patrick Tacussel (Montpellier), Stéphane Hugon (membre invité).
Salle des thèse E637, Galerie Claude Bernard, Escalier P, 1er étage, 12 rue cujas, 75005 Paris.
21 janvier 2011 à 14h : Emilie COUTANT: Le mâle du siècle: mutation et renaissance des masculinités. Archétypes, stéréotypes et néotypes masculins dans les iconographies médiatiques.
Jury : Michel Maffesoli (Sorbonne), Jean-Martin Rabot (Braga), Olivier Sirost (Rouen), Agnès Rocamora (Londres), Stéphane Hugon (membre invité).Amphi Durkheim, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
------------------------------------------
Invitations à l'Imaginaire 18 janvier 2011
le CeaQ a le plaisir de vous inviter à la rencontre du 18 janvier 2011 "Invitations à l'Imaginaire" sur le thème : «Le destin de l'univers»
Le bestiaire de l'astrophysique regorge de créatures étranges : blafardes "naines blanches", étoiles à "neutrons hyperdenses", "supernovae apocalyptiques" etc... Ces diverses métaphores montrent bien que le voyage au coeur de l'invisible recoupe les rêves, les fantaisies qui sont, de mémoire immémoriale, au coeur même de l'humaine nature.
Pour discuter de cela, Michel maffesoli, membre de l'Institut universitaire de France invite Marie-Odile Monchicourt, journaliste à France Info, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et Aurélien Fouillet, chercheur au CEAQ.
Mardi 18 janvier 2011 à 19h - entrée libre
Fondation d'Entreprise Ricard
12 rue boissy d'anglas
75008 Paris
Métro: Concorde ou Madeleine
www.fondation-entreprise-ricard.com
Le CEAQ (Centre d'Etude sur l'Actuel et le Quotidien) est un laboratoire de recherche à vocation internationale qui s'intéresse principalement aux nouvelles formes de socialité et à l'imaginaire sous ses formes multiples.
Centre d'Etude sur l'Actuel et le Quotidien Bâtiment Jacob - Bureau 527bis 45, rue des Saint Pÿres - 75006 Paris Tel / Fax : 00 33 (1) 42 86 46 34
12 janvier 2011 à 14h : Manuel BELLO: Des illuminations profanes. Une étude sur les formes de la perception urbaine contemporaine.
Jury : Michel Maffesoli (Sorbonne), Marc Perelman (Paris Ouest), Olivier Sirost (Rouen), Chris Younès (École spéciale d'architecture Paris), Amphi Durkheim, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
21 janvier 2011 à 10h : YiBing XU : La pensée primitive, Internet et la mort.
Jury : Michel Maffesoli (Sorbonne), Jean-Martin Rabot (Braga), Patrick Tacussel (Montpellier), Stéphane Hugon (membre invité).
Salle des thèse E637, Galerie Claude Bernard, Escalier P, 1er étage, 12 rue cujas, 75005 Paris.
21 janvier 2011 à 14h : Emilie COUTANT: Le mâle du siècle: mutation et renaissance des masculinités. Archétypes, stéréotypes et néotypes masculins dans les iconographies médiatiques.
Jury : Michel Maffesoli (Sorbonne), Jean-Martin Rabot (Braga), Olivier Sirost (Rouen), Agnès Rocamora (Londres), Stéphane Hugon (membre invité).Amphi Durkheim, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
------------------------------------------
Invitations à l'Imaginaire 18 janvier 2011
le CeaQ a le plaisir de vous inviter à la rencontre du 18 janvier 2011 "Invitations à l'Imaginaire" sur le thème : «Le destin de l'univers»
Le bestiaire de l'astrophysique regorge de créatures étranges : blafardes "naines blanches", étoiles à "neutrons hyperdenses", "supernovae apocalyptiques" etc... Ces diverses métaphores montrent bien que le voyage au coeur de l'invisible recoupe les rêves, les fantaisies qui sont, de mémoire immémoriale, au coeur même de l'humaine nature.
Pour discuter de cela, Michel maffesoli, membre de l'Institut universitaire de France invite Marie-Odile Monchicourt, journaliste à France Info, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et Aurélien Fouillet, chercheur au CEAQ.
Mardi 18 janvier 2011 à 19h - entrée libre
Fondation d'Entreprise Ricard
12 rue boissy d'anglas
75008 Paris
Métro: Concorde ou Madeleine
www.fondation-entreprise-ricard.com
Le CEAQ (Centre d'Etude sur l'Actuel et le Quotidien) est un laboratoire de recherche à vocation internationale qui s'intéresse principalement aux nouvelles formes de socialité et à l'imaginaire sous ses formes multiples.
Centre d'Etude sur l'Actuel et le Quotidien Bâtiment Jacob - Bureau 527bis 45, rue des Saint Pÿres - 75006 Paris Tel / Fax : 00 33 (1) 42 86 46 34
samedi, janvier 08, 2011
Mythanalyse du bonheur
Nous comparons notre vie réelle avec ce que pourrait être le bonheur auquel nous aspirons. Mais il nous est difficile de définir ce que serait pour nous cette félicité. Nous imaginons avoir ce qui nous manque, par exemple beaucoup d’argent, la liberté de disposer de notre temps, la jeunesse, la santé, l’amour, la pleine jouissance sexuelle, le pouvoir sur les autres, politique, charismatique, magique, ou telle autre jouissance dont l’un ou l’autre se sent privé. Peut-être quelques-uns citeront-ils aussi la sagesse, mais ils seront rares, tant cette vertu nous paraît inaccessible, restrictive ou ennuyeuse. Notre souffrance sur terre serait un manque, un déficit, éventuellement dramatique, de cet accomplissement de l’être qui est au cœur de notre existence, comme je l’ai souligné dans CyberProméthée*. Nous naissons faibles et inachevés, nous expérimentons une frustration profonde d’être sur le dos comme une tortue sans autonomie, de dépendre entièrement de nos parents nourriciers et protecteurs, et cette situation d’infans, d’être incomplet, dépendant, impuissant, terriblement vulnérable, constitue un traumatisme définitif du nouveau-né qui motivera ses désirs pour toujours lorsqu’il deviendra adulte. Le bonheur sera d’être pleinement achevé en tant qu’être vivant, pourvu de ce qui nous a manqué existentiellement. Nous en rêvons tous et la constitution américaine l’a inscrit dans son préambule comme un droit élémentaire et universel de l’homme. Cela se comprend comme la réaction de ceux qui s’étaient exilés d’Europe pour échapper aux empêchements de vivre et persécutions que leur imposaient l’Eglise et l’aristocratie catholiques en leur refusant un statut de citoyen à part entière. Cela se comprend aussi dans un pays neuf, entièrement à construire, qui rêve d’accomplissement. Voilà le premier élément d'interprétation que suggère une mythanalyse du bonheur.
Mais la sagesse populaire nous rappelle aussi que l’argent ne fait pas le bonheur, que la politique est cruelle, que la gloire est une vanité éphémère, qu’on se lasse de faire l’amour, qu’on s’ennuie si on ne travaille pas, etc. Il est difficile de savoir combler sa vie. L’obsession demeure le plus souvent d’avoir plus, dans l’espoir d’être plus. Mais l’avoir ne remplace pas l’être. En fait, personne ne sait bien finalement ce que serait son bonheur personnel, une fois comblés les manques élémentaires de sa vie individuelle, tels que solitude, maladie, pauvreté, et nous avons encore plus de difficulté à concevoir le bonheur collectif.
La quête du bonheur semble aussi vieille que l’homme. Les mythes anciens l’évoquent sur le modèle d’un paradis terrestre originel perdu, ou d’un paradis final auprès de Dieu à atteindre par l’effort. Faut-il, pour jouir du plein bonheur, être ingénu et ignorant ? Oui, si l’on se réfère au récit biblique d’Adam et Eve chassés pour avoir mordu dans la pomme de la conscience et de la connaissance. Oui, si l’on en croit aussi le mythe du bon sauvage construit par Jacques Cartier de retour du Canada, Bougainville, Cook et quelques autres voyageurs en Polynésie ou au Brésil et discutés par Montaigne au XVIe siècle, puis Diderot et Rousseau au XVIIIe. Etonnamment, c’est en invoquant la nature plutôt que la civilisation, l’innocence quasi infantile plutôt que la connaissance et le progrès humain, que ce mythe du bonheur originel s’est construit. L’invention du bon sauvage constitue manifestement une actualisation non explicitée du mythe biblique du paradis terrestre originel antérieur au savoir et à la civilisation.Voilà le deuxième élément que souligne la mythanalyse.
Le bonheur dont nous rêvons aujourd’hui serait donc pour une part celui dont nous croyons qu’il est possible, puisqu’il a déjà existé à l’origine de l’humanité, dans une innocence primitive qui offrait l’harmonie, l’abondance, la plénitude humaine. Il est fondé sur la nostalgie de l’état de nature antérieur à la civilisation humaine, que la connaissance - celle de la pomme édénique - tendrait à détruire. D’où cette idée communément répandue que le bonheur est plutôt dans les choses simples, naturelles, dans les sentiments purs, l’amour familial, en marge des ambitions humaines sociales, professionnelles, technoscientifiques, etc. Le bonheur serait donc régressif. Cette interprétation trouve son origine dans le mythe biblique et l’invention du péché originel qui nous prive définitivement du bonheur sur terre. L’homme, définitivement vaincu par Dieu, est condamné à souffrir sur Terre et aux enfers, à moins qu’il mérite par sa pieuse soumission religieuse d’accéder au paradis de Dieu après la mort ou à la fin des temps.
L’autre option est celle que nous avons héritée du mythe grec prométhéen. Au lieu de se soumettre à Dieu, l’homme choisit la voie grecque, celle de la révolte de Prométhée, qui dérobe le feu de Zeus pour le donner aux hommes. Le feu est équivalent à la pomme édénique : il symbolise lui aussi la conscience et la connaissance qui permet à l’homme de s’élever au-dessus de sa condition naturelle de soumission. Certes, Prométhée est puni, enchaîné et subit sans répit les agressions d’un aigle (symbole divin) qui lui dévore le foi (symbole de la connaissance). Mais un surhomme, Hercule, viendra le libérer de ses chaînes et le centaure Chiron lui donnera même l’éternité divine. A l’opposé du mythe biblique, nous sommes dans le mythe de la victoire de l’homme sur Dieu. L’humanité, par l’effort, le travail, la connaissance, la conscience qu’il développe tentera, de rivaliser avec les dieux et de réaliser le bonheur sur terre**.
L’Occident s’est fondé sur ces deux mythes contradictoires, le grec et le biblique. Et nous avons appris à vivre avec les deux, à aménager l’ambigüité qui en est résulté. Nous sommes à la fois nostalgiques du bonheur perdu et conquérant de notre bonheur à venir, doloristes et proactifs, pessimistes et optimistes, vaincus et vainqueurs. C’est sans doute à cette tension constante de notre imaginaire collectif que nous devons la voie originale de l’Occident, en comparaison des autres civilisations. C'est là le troisième élément d'une approche mythanalytique du bonheur.
Sommes-nous en Occident à ce point définitivement influencé, à notre corps défendant, par le mythe biblique? Aurions-nous pu y échapper ? De fait, il semble que l’imaginaire du bon sauvage soit le plus trompeur qui soit et que la souffrance inhérente à la condition humaine ait prévalu partout sur Terre. Les autres civilisations n’ont pas su faire mieux que nous. Elles ne semblent même pas avoir la même obsession du bonheur sur terre que la nôtre. L’animisme a abouti à de difficiles et incessantes tractations entre les vivants et les esprits. Il promet au mieux l’apaisement. Le bouddhisme est une tentative d’échapper à la souffrance terrestre en renonçant à soi-même et en se dissolvant dans le nirvana. Le confucianisme nous promet seulement la sagesse et la paix dans le respect des autres et la soumission aux rituels. Le taôisme invite au rejet des désirs et de l’action. Le syncrétisme hindou, trop complexe pour que nous le caractérisions en quelques mots, concilie le panthéisme et la réincarnation, une organisation sociale complexe très hiérarchisée et la maîtrise corporelle des fakirs. L’islam, qui fut une grande religion, ressemble de plus en plus dans ses dérives intégristes à un enfer sur terre qui menace de conquérir la planète par la violence.
Ce fut plutôt, semble-t-il un grand privilège pour l’Occident d’avoir célébré aussi le mythe de Prométhée. Une fois de plus, nous constatons ce que nous devons aux Grecs anciens. Certes, il nous semble que tous les efforts que nous mettrons à progresser sur la voie de la civilisation, de la connaissance, de la puissance, de la maîtrise médicale, sociale, psychologique et même éthique de notre avenir ne suffiront jamais à reconstituer ou remplacer le bonheur originel dont nous avons la nostalgie : voilà l’héritage biblique. Mais comme Sisyphe, nous continuons envers et contre tout à croire au progrès et à y investir tous nos efforts : voilà l’héritage grec. Bien étrange paradoxe que le nôtre, qui semble définir l’existence humaine.
Où en somme-nous donc aujourd’hui dans notre quête du bonheur en Occident? Nous constatons que notre civilisation, après avoir échoué lamentablement dans la voie des utopies socio-politiques du XIXe siècle, s’est tournée aujourd’hui vers le mirage d’un bonheur fondé sur la richesse, la consommation matérielle et sexuelle, et les promesses posthumanistes de l’utopie technoscientifique. Mais elle doute de cette voie, qui semble devoir nous décevoir toujours, au point de célébrer et nous vendre simultanément son contraire : le culte naturiste du corps, le paradis océanique du Club Méditerranée, les médecines douces et la nourriture biologique, la reconstitution de l’équilibre naturel des écosystèmes, voire l’émigration urbaine et le retour à la vie rurale. Le primitivisme tahitien de Paul Gauguin est devenu emblématique, mais le cybermonde aussi. Comme si nous étions convaincus que le numérique est notre potion magique ultime, notre poudre de Perlimpinpin. Enfin le bonheur grâce au numérique qui va nous permettre d’accéder à la béatitude intelligente du posthumanisme ! Impossible d’y croire ! Nous sommes toujours dans ce même paradoxe qui caractérise l’Occident.
En quittant le froid mois de janvier du Québec et en emportant ma tablette magique de Las Vegas à Tahiti j’aurai donc la nature et le numérique réunis sur un hamac branché sous un cocotier. Voilà ce à quoi nous aspirons : disposer de la puissance numérique la plus sophistiquée dans le paradis terrestre le plus naturel ou originel qui soit. Je devrais juste ignorer ou oublier que les populations de ces iles paradisiaques ont été déchirées par des guerres, que les colonisateurs y ont causé des maladies dévastatrices, que les missionnaires ont traité les indigènes de cannibales*** et les vahinés de prostituées pour justifier leurs conversions massives, que l’économie y est très difficile, que la France y a installé en 1963 le Centre d’expérimentation du Pacifique pour mener à termes ses essais de bombe atomique. Bref, il faut bien l’admettre, ce rêve de paradis terrestre qu’on nous vend avec les séductions d’un marketing savamment conçu, ne doit son succès qu’à notre nostalgie de bonheur naturel, qui compense nos difficultés existentielles réelles, mais il ne reflète pas la vie de ces populations prétendument privilégiée. Le paradis terrestre n’existe pas pour elles. Et il n’a jamais existé ailleurs que dans notre imagination.
En dehors de nos illusions de vacances, seul le mythe prométhéen de construction de notre condition humaine est valide et nous n’avons pas d’autre option. La mythanalyse n'est pas qu'une interprétation des mythes; elle prend aussi position, elle propose de choisir entre les mythes, car il y en a qui peuvent nous aider à vivre plus que d'autres et guider notre action, en fonction des valeurs que nous choisissons; Je l'ai toujours dit: la mythanalyse n'est pas une science, et quoiqu'il en soit de la mythanalyse, toutes les théories, selon elle, sont des fictions. La mythanalyse aussi, mais une fiction qui nous aide à être plus lucides et plus libres! Je n'ai ici aucune crainte des paradoxes, je les assume. La pensée créatrice est nécessairement paradoxale, comme la plupart des "vérités".
Hervé Fischer
-------------------------------------------------
*CyberProméthée,éditions vlb, 2003
**Nous serons des dieux, éditions vlb, 2006
*** Il est vrai que le cannibalisme n'a été officiellement aboli aux îles Marquises qu'en 1867.
Libellés :
bon sauvage,
bouddhisme,
hindouisme,
islam,
mythe biblique,
numérique,
Occident,
paradis terrestre,
Paul Gauguin,
Prométhée,
Tahiti,
taoisme
jeudi, janvier 06, 2011
Agnosticisme et athéisme
Nombreux sont ceux, y compris des scientifiques*, qui se déclarent agnostiques et rejettent l’athéisme. Ils affirment qu’on ne peut pas savoir si Dieu n’existe pas, puisqu'on ne peut pas le démontrer scientifiquement et qu’il est donc exclu d’aller au-delà de leur principe de prudence sceptique. Plusieurs dénoncent même l’athéisme en le considérant comme une croyance équivalente et symétrique de la foi. Croire que Dieu existe, ou croire que Dieu n’existe pas, ce serait le même genre de croyance, dont tout scientifique doit s’abstenir, car la raison et la foi sont de nature exclusive l'une de l'autre.
Voilà bien une étonnante symétrie ! On ne peut pas démontrer davantage que le Père Noël ou les loups-garous n’existent pas. Et pourtant les scientifiques n’y croient pas ! L’athéisme n’est aucunement une croyance en la non-existence de Dieu : il est une absence de prise en compte de cette imagination qui n’explique finalement rien. Comme plusieurs l’ont souligné, Dieu est une hypothèse inutile**. La science n’en voit aucune preuve et n’y trouve aucune compréhension supplémentaire des questions qu’elle se pose sur l’univers. Autant croire que la couleur bleue explique l’origine de ce qui existe : après des siècles de théologie sur la couleur bleue, l’édification d’Eglises, la vénération du verre bleu ou de la Méditerranée ou du ciel, on ne serait pas rendu plus avant dans l’explication crédible de l’univers. Pire, on aurait perdu son temps et subit les effets terriblement pervers des martyres, des croisades, des intégrismes et des guerres de religion entre les croyants dans plusieurs nuances de bleu, entre les prosélytismes de plusieurs Eglises, et tout ce qu’implique le règne conquérant d’une superstition majeure.
C’est un pur sophisme que d’opposer comme deux croyances égales la foi en Dieu et l’athéisme, et de faire de l’athéisme une autre religion. Ses excès dans les pays sous dictature communiste sont déplorables, mais insignifiants en comparaison des terribles abus des religions. Et ils ont moins à voir avec l’athéisme qu’avec les effets de toute dictature qui veut contrôler les esprits sans partage, sans tolérer l’existence d’institutions non-étatiques dans l’Etat.
La pensée matérialiste, celle que doit avoir tout scientifique rigoureux dans ses hypothèses et ses méthodes, est nécessairement athée. A moins de n’avoir pas compris ce qu’est le matérialisme. Si, rejetant tout deus ex machina, qu’on l’appelle Dieu, le dessin intelligent ou la couleur bleue ou verte, on s’en tient à une recherche des lois physiques et chimiques du couple matière/énergie, incluant la recherche atomique, électromagnétique, génétique et leurs équilibres thermodynamiques, on exclut toute référence à Dieu, que ce soit pour ou contre, on ignore cette pensée. Voilà ce qu’est l’athéisme.
L'agnosticisme cache mal, selon moi,un sédiment inconscient de culture et de crainte religieuse. Nous avons encore du mal à oser être pleinement des animaux matérialistes.On ne peut pas non plus s'arranger de deux postures, l'une agnostique par raison, l'autre athée par sentiment*** ou conviction d'engagement idéologique. Ce genre d'ambiguïté trahit une mollesse de la pensée dont il faut se débarrasser. La pensée matérialiste pleinement assumée, autant que nous y parvenions malgré nos réflexes culturels déistes, qui resurgissent sans cesse, souvent à notre insu, est beaucoup plus porteuse de compréhension de l'univers et de liberté humaine. Voilà une résolution à prendre en ce début d'année!
Hervé Fischer
-----------------------------------
* Je réponds ici notamment à Cyrille Barette, contributeur à "Heureux sans Dieu" et auteur de "Mystère sans magie", éditions Multimondes, Montréal,2006.
** C'est ce que souligne Yanick Villedieu, autre contributeur au même livre, "Heureux sans Dieu", où j'ai moi-même signé le chapitre "Mythanalyse de Dieu".
*** C'est le propos d'Yves Gingras dans ce même livre; on regrette qu'il ne l'ai pas davantage développé, ce qui aurait permis d'en venir à bout.
mercredi, janvier 05, 2011
Métaphore de l'embryologie dans ULYSSE de James JOYCE, par Daniel Becquemont
Nous avons le plaisir de vous informer de la suite du SÉMINAIRE DU CENTRE ALEXANDRE KOYRÉ, co-organisé par notre ami le Pr. Jean-Louis FISCHER, sur le thème des "REPRÉSENTATIONS DE L'EMBRYON ET DU FOETUS HUMAINS".
Le jeudi de 17H à 19H, Muséum National d'Histoire Naturelle, Pavillon Chevreul, 57 rue Cuvier, 75005 Paris.
Prochaine rencontre:
Jeudi 6 janvier: Pr. Daniel BECQUEMONT (Université de Lille), "Métaphore de l'embryologie dans ULYSSE de James JOYCE".
Bien cordialement.
*****************
Christian LAVIGNE
Secrétaire Général d'ARS MATHEMATICA
Co-fondateur d'INTERSCULPT
http://www.arsmathematica.org
http://web.cast.free.fr
Présentation de Daniel Becquemont: http://www.dailymotion.com/video/x9vbid_daniel-becquemont-lille_news
Le jeudi de 17H à 19H, Muséum National d'Histoire Naturelle, Pavillon Chevreul, 57 rue Cuvier, 75005 Paris.
Prochaine rencontre:
Jeudi 6 janvier: Pr. Daniel BECQUEMONT (Université de Lille), "Métaphore de l'embryologie dans ULYSSE de James JOYCE".
Bien cordialement.
*****************
Christian LAVIGNE
Secrétaire Général d'ARS MATHEMATICA
Co-fondateur d'INTERSCULPT
http://www.arsmathematica.org
http://web.cast.free.fr
Présentation de Daniel Becquemont: http://www.dailymotion.com/video/x9vbid_daniel-becquemont-lille_news
Babel et Sisyphe
Le mythe de la Tour Babel a été toujours négativement interprété par les exégètes chrétiens, alors que j'y découvre l'expression du désir de l'humanité de s'élever. Une aspiration vers Dieu, comme dans la construction des cathédrales, ou une aspiration de l'humanité à s'élever avec ses propres forces vers un stade supérieur de son évolution, vers plus de puissance et pourquoi pas aussi vers plus d'intelligence et de sagesse, compte tenu de cette sorte de topologie verticale de notre imaginaire entre le haut et le bas, le supérieur et l'inférieur.
Je l'ai déjà souligné souvent aussi, le mythe de la Tour de Babel est le premier mythe de la communication, fondateur de notre société de l'information et des médias sociaux.
Et nous sommes conduits à y associer le mythe grec de Sisyphe, ce roi puni lui aussi, par Zeus, qui chaque matin remet sa lourde
charge sur ses épaules pour remonter la montagne dont la pente le fera retomber chaque soir à son pied. Sisyphe symbolise lui aussi notre désir humain d'élévation. Sisyphe est celui qui tente chaque jour de porter plus haut sur ses épaules une lourde pierre de l'édifice dont nous sommes les bâtisseurs: l'humanité.
Les théories sont des histoires fictives de désir et de peur qui nous apaisent provisoirement. Les mythes sont des récits explicatifs des origines et des fins de l’humanité.
Le mythe de la Tour de Babel qui mettait en scène l’éclatement d’une humanité punie pour son ambition à s’élever, ne fonde-t-il pas aujourd’hui la richesse créatrice de sa diversité? N’est-il pas le plus contemporain des mythes, celui qui nous invite à édifier le futur ?
Et n’exige-t-il pas alors paradoxalement de tisser les liens d’une solidarité planétaire pour reprendre ensemble, comme autant de Sisyphe, la construction de cette tour porteuse de nos espoirs ?
Hervé Fischer
Je l'ai déjà souligné souvent aussi, le mythe de la Tour de Babel est le premier mythe de la communication, fondateur de notre société de l'information et des médias sociaux.
Et nous sommes conduits à y associer le mythe grec de Sisyphe, ce roi puni lui aussi, par Zeus, qui chaque matin remet sa lourde
charge sur ses épaules pour remonter la montagne dont la pente le fera retomber chaque soir à son pied. Sisyphe symbolise lui aussi notre désir humain d'élévation. Sisyphe est celui qui tente chaque jour de porter plus haut sur ses épaules une lourde pierre de l'édifice dont nous sommes les bâtisseurs: l'humanité.
Les théories sont des histoires fictives de désir et de peur qui nous apaisent provisoirement. Les mythes sont des récits explicatifs des origines et des fins de l’humanité.
Le mythe de la Tour de Babel qui mettait en scène l’éclatement d’une humanité punie pour son ambition à s’élever, ne fonde-t-il pas aujourd’hui la richesse créatrice de sa diversité? N’est-il pas le plus contemporain des mythes, celui qui nous invite à édifier le futur ?
Et n’exige-t-il pas alors paradoxalement de tisser les liens d’une solidarité planétaire pour reprendre ensemble, comme autant de Sisyphe, la construction de cette tour porteuse de nos espoirs ?
Hervé Fischer
Libellés :
avenir,
bâtisseur,
communication,
diversité,
élévation,
espoir,
liens,
mythes contemporains du Québec,
théorie
lundi, janvier 03, 2011
Mythanalyse de mai 68
Les agitations étudiantes des années 60-70 ne se sont pas limitées à l’Europe de l'Ouest, mais ont gagné aussi les Etats-Unis. L'effet de surprise, l'intensité et la généralisation internationale de ces révoltes étudiantes ont été considérablement renforcées par un choc démographique: l'arrivée soudaine et en grand nombre des baby-boomers, nés au lendemain de la seconde guerre mondiale, et qui atteignent l'âge adulte en 1968. Du fait de leur nombre soudain, ils se heurtaient aussi à un chômage grandissant, qui ne leur laissait guère d'espoir de s'intégrer rapidement dans une société adulte qu'ils rejetèrent donc. Fils de bourgeois nantis, ils furent nombreux à prolonger leurs études, ce qui a contribué à renforcer la révolte universitaire. Il n'en était pas de même des jeunes ouvriers, que le marché du travail pouvait mieux accueillir, qui en étaient restés au mythe de la révolution marxiste, et qui ne s'associèrent pas à ce gauchisme bourgeois. Après coup, on pourra affirmer que Mai 68 était démographiquement et sociologiquement prévisible et inévitable. Mais la libération idéologique de mai 68 constitue aussi un objet d’étude qui s’impose à la mythanalyse, puisque ce fut un moment extraordinaire d’explosion de l’imaginaire collectif.
Cette crise de mai 68, qui s’est tellement réclamée de la sociologie et que pourtant les sociologues ont tant de mal à comprendre, personne n'a l’a vu venir. Elle a été l'expression d'une prise de conscience par la nouvelle génération du décalage entre l'idéologie bourgeoise dominante, encore catholique, rurale et hiérarchisée, qu'ils subissaient et une aspiration à de nouvelles valeurs dont ils ont eu l'intuition confuse. L'imagination au pouvoir, la grogne contre l'autorité n'exprimaient rien d'autre. Les intellectuels formés dans l'idéologie bourgeoise de leur génération ne pouvaient pas les comprendre, sinon y apporter leur soutien politique par instinct. Le gauchisme de la nouvelle génération bourgeoise, s'est opposé à la gauche classique (socialiste et communiste) autant qu'à la droite, parce qu'il était l'expression d'une révolte par rapport à l'ancien système social et idéologique, toutes positions confondues.
Si on lit à rebours Mai 68 comme une aventure qui avant de se finir par une grève générale de 10 millions de travailleurs avait commencé par un problème d’accessibilité des garçons au dortoir des filles, on comprend l’importance des slogans du type “ sexualité et lutte de classes ” de l’extrême gauche française au début des années 70. Et il s’agissait bien d’une libération sexuelle contre tous les tabous de la société adulte, attisée par la mise en vente de la pilule contraceptive à l’automne 1967. Nous avons assisté à une exaltation de la libido sociale et individuelle, du désir, de la liberté, du rejet affiché de l’effort et du travail. On s’est mis à parler doctement des « machines désirantes », des dispositifs de « l’économie libidinale ». L’audace surréaliste de slogans tels que « sous les pavés la plage » en appelait à André Breton, le poète du pouvoir de l’imagination. Mai 68 a été la réponse d’une puissante vague démographique au blocage autoritaire de la génération précédente, sous forme d’une pulsion sociale libératrice. Les gauchistes et les situationnistes, qui en ont exprimé les fondements idéologiques, ne pouvaient que s’en prendre au pouvoir des médias de masse alors sous contrôle politique direct et à la société d’un « spectacle » qui n’était pas le leur. La mythanalyse a beaucoup à dire sur Mai 68, encore si mal compris. Nous y travaillons.
Hervé Fischer
dimanche, janvier 02, 2011
Peut-on discerner une intentionnalité dans l'évolution de la nature?
Je n’ai jamais adhéré au mythe biblique du chaos, dont un être supérieur nous aurait arrachés en créant un monde ordonné pour nous. Certes, nous observons à quel point la matière et l’énergie sont organisés, même pour provoquer leurs pires destructions. Il y a dans le couple matière-énergie un évident dispositif organisationnel de réactions atomiques,physiques, chimiques, organiques, thermodynamique, une intelligence de la matière, comme aurait dit Spinoza. Cela apparaît même dans les big bangs. Cette énergie intelligente qui se lit dans la nature et qui opère dans la matière-énergie, je crois que nous en sommes pleinement partie. Cela revient à supposer une sorte de rationalité matérialiste dans le fonctionnement de la nature, cette rationalité même qu'élabore ou déchiffre la science actuelle.
Mais la question qui se pose alors inévitablement à nous, c'est de discerner s'il y aurait une intentionnalité dans cette évolution, nécessairement elle aussi rationnelle de la nature. Car comment le fonctionnement de la nature pourrait-il obéir à des lois rationnelles et évoluer irrationnellement. La contradiction est absurde. Nous voilà donc, avec cette question si simplement apparue, et d'apparence si naïve, en plein débat métaphysique. Il est étonnant de constater à quel point cette question a été occultée.
Lorsque nous avons inventé les dieux, tout s'expliquait en fonction des caprices et des disputes des occupants de l'Olympe, comme dans les familles humaines. Mais lorsque nous avons inventé Dieu, le dieu monothéiste, il fallut bien se demander pourquoi ce dieu s'était donné tant de peine. Pourquoi avoir créé l'homme et un univers où le mettre. Par masochisme? Pour se punir lui-même? Pour mesurer sa force? Malgré lui? Pour se distraire? Pour organiser un combat dramatique entre lui et le dieu du mal, une lutte à finir dont nous serions les pions? La question demeure ouverte dans une béance vertigineuse et aucune théologie ne nous a jamais proposé de réponse. Nous en sommes réduits à célébrer le grand mystère divin, et à admettre humblement nos limites. Autant dire que nous ne sommes pas plus avancés dans notre quête de compréhension qu'avant avoir inventé Dieu.Nous avons seulement compliqué le débat avec une hypothèse inutile.
Revenons au point de départ. En admettant la rationalité quasi mécanique, chimique, électromagnétique, génétique, etc. de la nature, selon laquelle les mêmes dispositifs - atmosphériques, géologiques, mécaniques, génétiques, etc. - créent les mêmes effets, en admettant donc une organisation rationnelle de la nature, que nous appelons son intelligence, nous demeurons au simple constat, sur lequel nous nous entendrons tous, créationnistes et rationalistes. Mais en admettant que la nature évolue, ce qui est difficilement contestable, encore que les créationnistes s'y refusent, nous sommes conduits à admettre aussi que cette évolution obéit nécessairement à des lois rationnelles, donc à la même intelligence qui régit son fonctionnement. Deux options se présentent alors à nous:
1 - Cette évolution est rationnelle, mais elle n'a pas de but. C'est alors à nous nécessairement, si nous tenons à la vie, d'en organiser l'évolution, de la soumettre, dans le mesure du possible, à notre intelligence et à nos propres buts, qu'il nous faut définir et respecter.
2 - Cette évolution est rationnelle, donc elle a nécessairement un but rationnel, ce qui constitue une intentionnalité et supposerait,, selon notre expérience humaine, une conscience. La nature aurait-elle une intelligence, une conscience et une intentionnalité?
Oui, nécessairement!
Les questions posées par ces deux options résultent logiquement de nos constats précédents et nous sommes capables de les formuler clairement. Mais ce sont toujours les questions les plus simples qui sont les plus difficiles. Nous nous en tiendrons là pour aujourd'hui.
A partir d'une interprétation matérialiste de la nature, nous nous sommes retrouvés devant une question téléologique, sans qu'elle soit théologique, tout en en ayant toutes les apparences. Bref, en appelant la nature Dieu, comme Spinoza, ou en remplaçant Dieu par la nature, comme l'exige la philosophie matérialiste, nous nous retrouvons devant la même question. Pour aller plus loin, voyons si la nuit nous portera conseil. Ou ce que notre boite à outils mythanalytique nous proposera.
Hervé Fischer
Libellés :
Dieu,
intelligence,
matérialisme,
métaphysique,
nature,
Spinoza,
téléologie,
théologie
vendredi, décembre 31, 2010
Mille milliards de chaos
Milliards d’humains, d’informations, d’oiseaux, de bactéries, d’étoiles, milliards de milliards de gènes, d’électrons, d’éclats brillants et invisibles d’univers agités et de mouvements browniens. Chaos où nous dessinons des liens aléatoires, de la pensée linéaire et des arabesques vertigineuses aux limites de l’impensable, de l’inimaginable. Singularités infranchissables dont nous sommes. Instabilités où nous tentons d’esquisser des mythes et des cosmos dans les fragments de nos consciences impressionnistes : voilà le monde auquel nous voulons donner un sens!
Depuis des millions d’années, nous apprenons à lire, nous, les humains analphabètes de ce monde qui ne semble pas illisible. En attendant, nous en parlons sans cesse, nous inventons sans répit des dieux et des raisons, et nous leur attribuons des milliards d’histoires disparates. Et aujourd’hui, la vitesse a pris la relève de l’espace temps géométrique dans lequel nous nous étions installés. La vitesse est-elle destructrice ou fondatrice et partie prenante d'un ordre?Comment pourrions-nous échapper à la métaphysique, ses illusions et ses limythes, lorsque nous essayons de formuler une interprétation du monde?
Nous sommes des fabulateurs de mythes.
Nous tentons de surimposer l'ordre d'un cosmos au sentiment d'un chaos cosmogonique. Mais il n'est pas sûr que l'univers soit un chaos.
Hervé Fischer
Depuis des millions d’années, nous apprenons à lire, nous, les humains analphabètes de ce monde qui ne semble pas illisible. En attendant, nous en parlons sans cesse, nous inventons sans répit des dieux et des raisons, et nous leur attribuons des milliards d’histoires disparates. Et aujourd’hui, la vitesse a pris la relève de l’espace temps géométrique dans lequel nous nous étions installés. La vitesse est-elle destructrice ou fondatrice et partie prenante d'un ordre?Comment pourrions-nous échapper à la métaphysique, ses illusions et ses limythes, lorsque nous essayons de formuler une interprétation du monde?
Nous sommes des fabulateurs de mythes.
Nous tentons de surimposer l'ordre d'un cosmos au sentiment d'un chaos cosmogonique. Mais il n'est pas sûr que l'univers soit un chaos.
Hervé Fischer
Libellés :
agitation,
cosmogonie,
fabulation,
vitesse
jeudi, décembre 30, 2010
Mythanalyse du corps humain
Il est difficile de dire ce qu’est l’être humain en dehors des représentations visuelles successives qu’il s’est fait de lui-même. Et celles-ci, essentiellement culturelles, se sont étrangement transformées au fil des siècles. Les images paléolithiques nous montrent plus d’animaux que d’hominidés. Et les dessins des animaux des grottes préhistoriques sont très réalistes et précis, tandis que l’homme se représentait seulement sous forme symbolique : sculptures magiques de la fécondité (Venus de Willendorf 23000 ans avant notre ère) ou pictogrammes de silhouettes humaines en quelques traits schématisés. Dans l’art premier, notamment africain, il en est de même : c’est plus l’esprit que le corps qui est évoqué, son statut social et ses pouvoirs animistes. La civilisation égyptienne ancienne a magnifié le corps humain, mais elle aussi selon des conventions symboliques, religieuses et politiques abstraites, et en l’hybridant souvent aux animaux sacrés.
Les Grecs anciens ont été les premiers à célébrer dans leurs temples la beauté plastique du corps humain et son anatomie musculaire précise et réaliste, plutôt que de multiplier les sculptures animistes de serpents, dragons, singes, chats, oiseaux ou végétaux des autres civilisations. Pour en glorifier l’image, ils ont recouru à la noblesse lumineuse du marbre blanc. Puis nous observons, selon les époques, les sociétés et les cultures, des tendances tantôt très réalistes, tantôt abstraites, religieuses et symboliques. Dans l’islam et le protestantisme, c’est même l’interdiction de toute représentation visuelle de dieu et de création, y compris l’homme qui s’est imposée.
La représentation de l’humain, spirituelle ou corporelle, est iconique de chaque culture ; elle synthétise les rapports que l’homme construit entre lui et l’univers, donc sa propre image dans celle du monde, selon la cosmogonie et les interprétations idéologiques qu’il adopte. Qu’en est-il alors de l’homme de la modernité occidentale. Il était nécessaire de faire ce rappel historique pour mieux comprendre la signification des mutations actuelles.
La sculpture et la peinture européennes ont transformé nos représentations classiques de l’humain, principalement du point de vue perceptif de la réalité visible : convention réaliste, impressionnisme, naturalisme, fauvisme, cubisme, surréalisme, hyperréalisme, etc. Le sentimentalisme romantique, puis le symbolisme (qui a eu un fort impact dans la sculpture qui a suivi), ont maintenu une tradition plus spirituelle. Le futurisme et le réalisme socialiste, mais aussi un Fernand Léger, ont tous célébré, quoique de façon très différente, la nouvelle puissance de la technologie et de l’homme prométhéen, constructeur d’un monde nouveau.
Les artistes qui ont rapporté des dessins des camps de concentration, et les postmodernes deepuis, comme Christian Boltanski, Arnulf Rainer, mais aussi des sculpteurs comme Giacometti, Eva Hesse, Louise Bourgeois, Betty Goodwin, ont exprimé le malaise, la souffrance, la fragilité, l’éphémérité, la destruction de l’homme, cédant souvent à une grande morbidité. Mais ce sont les artistes de la performance et de l’art corporel des années 1960 et 1970, des artistes comme Hermann Nitsch, Gina Pane, Michel Journiac, Vito Acconci, Chris Burden, qui ont exprimé de la façon la plus extrême la douleur, le désenchantement, le catastrophisme, voire le nihilisme de notre époque. Ces représentations doloristes, masochistes évoquent nettement la tradition chrétienne biblique de flagellation, de la punition du corps. Certes, l’intention n’en était nullement exprimée clairement par ces artistes, mais les références nombreuses et explicites que faisaient Michel Journiac et les actionnistes viennois à la religion en témoignent clairement.
Il est d’autant plus étrange qu’en 40 ans nous soyons passés d’un extrême à l’autre : nous optons aujourd’hui pour une attitude extrêmement optimiste, mais selon deux directions étonnamment contradictoires, du moins en apparence.
D’un côté nous valorisons le corps naturel, nous l’icônisons dans la publicité, qui promeut et vend les produits d’une industrie florissante de la beauté du corps – naturisme, nudité, gymnastique, body building, maquillage qui rehausse le naturel, chirurgie plastique qui permet de lutter contre le vieillissement, santé par les produits naturels, etc.
D’autre part, des gourous nous proposent une nouvelle représentation du corps grâce aux technologies numériques. Cette utopie technoscientifique posthumaniste correspond à un nouvel espoir cosmogonique et nous annonce une superpuissance humaine arrimée aux technologies informatiques. Des représentants majeurs des arts scientifiques, tels Stelarc, Eduardo Kac, le mouvement australien Symbiotica usent de prothèses, manipulent l’ADN, rêvent de nanotechnologies, conçoivent l’espoir d’un être humain chimérique, qui cèderait son pouvoir cérébral à l’informatique pour une nouvelle ère de notre évolution humaine, jusqu’à un dépassement radical de l’humain par le silicium intelligent.
Quelle que soit l’opposition de ces démarches, l’une naturaliste, l’autre numérique, c’est dans les deux cas par l’artifice que nous tendons à doter notre corps de beauté et de force supérieures. Dans les deux cas, il s’agit d’un rejet de l’idéologie biblique et d’un retour à la pensée et à la sensibilité grecques, celles de la beauté du corps humain à célébrer, et à renforcer selon notre instinct prométhéen, celui de l’homme créateur de lui-même. Un rêve de puissance. Nous voulons devenir à notre tour des dieux, beaux comme des dieux, puissants comme des dieux*.
Hervé Fischer
-----------------------------
*"Nous serons des dieux", éditions vlb, Montréal, 2007
Les Grecs anciens ont été les premiers à célébrer dans leurs temples la beauté plastique du corps humain et son anatomie musculaire précise et réaliste, plutôt que de multiplier les sculptures animistes de serpents, dragons, singes, chats, oiseaux ou végétaux des autres civilisations. Pour en glorifier l’image, ils ont recouru à la noblesse lumineuse du marbre blanc. Puis nous observons, selon les époques, les sociétés et les cultures, des tendances tantôt très réalistes, tantôt abstraites, religieuses et symboliques. Dans l’islam et le protestantisme, c’est même l’interdiction de toute représentation visuelle de dieu et de création, y compris l’homme qui s’est imposée.
La représentation de l’humain, spirituelle ou corporelle, est iconique de chaque culture ; elle synthétise les rapports que l’homme construit entre lui et l’univers, donc sa propre image dans celle du monde, selon la cosmogonie et les interprétations idéologiques qu’il adopte. Qu’en est-il alors de l’homme de la modernité occidentale. Il était nécessaire de faire ce rappel historique pour mieux comprendre la signification des mutations actuelles.
La sculpture et la peinture européennes ont transformé nos représentations classiques de l’humain, principalement du point de vue perceptif de la réalité visible : convention réaliste, impressionnisme, naturalisme, fauvisme, cubisme, surréalisme, hyperréalisme, etc. Le sentimentalisme romantique, puis le symbolisme (qui a eu un fort impact dans la sculpture qui a suivi), ont maintenu une tradition plus spirituelle. Le futurisme et le réalisme socialiste, mais aussi un Fernand Léger, ont tous célébré, quoique de façon très différente, la nouvelle puissance de la technologie et de l’homme prométhéen, constructeur d’un monde nouveau.
Les artistes qui ont rapporté des dessins des camps de concentration, et les postmodernes deepuis, comme Christian Boltanski, Arnulf Rainer, mais aussi des sculpteurs comme Giacometti, Eva Hesse, Louise Bourgeois, Betty Goodwin, ont exprimé le malaise, la souffrance, la fragilité, l’éphémérité, la destruction de l’homme, cédant souvent à une grande morbidité. Mais ce sont les artistes de la performance et de l’art corporel des années 1960 et 1970, des artistes comme Hermann Nitsch, Gina Pane, Michel Journiac, Vito Acconci, Chris Burden, qui ont exprimé de la façon la plus extrême la douleur, le désenchantement, le catastrophisme, voire le nihilisme de notre époque. Ces représentations doloristes, masochistes évoquent nettement la tradition chrétienne biblique de flagellation, de la punition du corps. Certes, l’intention n’en était nullement exprimée clairement par ces artistes, mais les références nombreuses et explicites que faisaient Michel Journiac et les actionnistes viennois à la religion en témoignent clairement.
Il est d’autant plus étrange qu’en 40 ans nous soyons passés d’un extrême à l’autre : nous optons aujourd’hui pour une attitude extrêmement optimiste, mais selon deux directions étonnamment contradictoires, du moins en apparence.
D’un côté nous valorisons le corps naturel, nous l’icônisons dans la publicité, qui promeut et vend les produits d’une industrie florissante de la beauté du corps – naturisme, nudité, gymnastique, body building, maquillage qui rehausse le naturel, chirurgie plastique qui permet de lutter contre le vieillissement, santé par les produits naturels, etc.
D’autre part, des gourous nous proposent une nouvelle représentation du corps grâce aux technologies numériques. Cette utopie technoscientifique posthumaniste correspond à un nouvel espoir cosmogonique et nous annonce une superpuissance humaine arrimée aux technologies informatiques. Des représentants majeurs des arts scientifiques, tels Stelarc, Eduardo Kac, le mouvement australien Symbiotica usent de prothèses, manipulent l’ADN, rêvent de nanotechnologies, conçoivent l’espoir d’un être humain chimérique, qui cèderait son pouvoir cérébral à l’informatique pour une nouvelle ère de notre évolution humaine, jusqu’à un dépassement radical de l’humain par le silicium intelligent.
Quelle que soit l’opposition de ces démarches, l’une naturaliste, l’autre numérique, c’est dans les deux cas par l’artifice que nous tendons à doter notre corps de beauté et de force supérieures. Dans les deux cas, il s’agit d’un rejet de l’idéologie biblique et d’un retour à la pensée et à la sensibilité grecques, celles de la beauté du corps humain à célébrer, et à renforcer selon notre instinct prométhéen, celui de l’homme créateur de lui-même. Un rêve de puissance. Nous voulons devenir à notre tour des dieux, beaux comme des dieux, puissants comme des dieux*.
Hervé Fischer
-----------------------------
*"Nous serons des dieux", éditions vlb, Montréal, 2007
mardi, décembre 28, 2010
Mythanalyse du numérique
Depuis l’émergence de l’âge du numérique, nous voilà replongés dans l’obscurité de la caverne de Platon. Le réel est dévalorisé et passe pour un jeu de simulacres et d’ombres, dont nous nous échappons en nous tournant vers la lumière bleutée de nos écrans d’ordinateurs, où nous apparaissent les « eidos » numériques, beaucoup plus vrais et riches en informations scientifiques et instrumentales que les perceptions de nos cinq sens en basse résolution. L’intelligence dite « collective » se répand dans la noosphère qui entoure désormais la planète Terre, et nous pouvons connaître et concevoir grâce au numérique le monde virtuel auquel nous aspirons. Oublions le réalisme trivial, la science d’observation et d’expérimentation : la vérité se situe dans la pensée d’un irréel invisible. C’est cette attitude mentale, quasi spirituelle, que j’appelle « le numérisme », et qui est une nouvelle déclinaison technologique de l’idéalisme platonicien.
Il n’y manque plus que Dieu. Le numérisme n’a pas manqué de créer une sorte de religion, avec ses communautés virtuelles, telles les églises Apple, Microsoft, Google, Facebook, ou les paroisses Myspace, Youtube, Twitters, Skype, leurs fidèles et leurs infidèles, des codex pour les initiés, une discrimination entre ceux qui sont connectés, sans cesse connectés à ce monde supérieur - les intelligents -, et ceux qui ne le sont pas - les païens, les obscurantistes. Et le posthumanisme nous annonce une sorte de paradis intelligent à venir sous le règne du numérique.
Il est étonnant de constater que le réalisme, né avec la Renaissance, pourtant si instrumental de notre puissance occidentale, n’aura guère duré plus de cinq siècles, un instant en comparaison des milliers d’années d’évolution de notre espèce. Nous n’aimons pas les païens, ni les athées, ni les démystificateurs. Nous voulons des dieux, des intelligences supérieures – aujourd’hui celle du Grand Ordinateur* -, nous avons besoin d’excommunications, de dépendance, de soumission. Nous nous berçons encore d’illusions et de chimères, un doux mélange d’idéalisme platonicien, de magie numérique, avec ses rites, ses initiations, ses célébrations, ses marchands du temple, ses prêtres, ses gourous, ses chamans et les formules de sorcellerie de ses algorithmes. Et dire que nous nous croyons modernes ! Et même postmodernes ! Posthistoriques !
Paradoxalement, seuls les philosophes nous invitent quasiment tous à nous détourner de ce nouvel idéalisme. Ils n’en ont pas encore perçu le pouvoir intellectuel et spirituel. Ils se gargarisent encore de Platon, de ses leurres et de ses fantasmes, sans avoir compris que nous y sommes revenus, étonnamment par le biais de la technologie, comme avait su le comprendre McLuhan. Au nom d’un humanisme vieillot, au nom de la philosophie, ils veulent nier l’importance radicale de la révolution informatique et son impact sur notre civilisation et précisément sur nos idées. Ils se sont trompés d’adversaire. Ils devraient plonger dans le numérisme avec ferveur.
Nous voilà donc confrontés à de grands malentendus, comme il est arrivé si souvent dans l’histoire des idées. Les philosophes ont raison de se méfier du numérisme, mais ils ne le critiquent pas pour les bonnes raisons ; d’ailleurs ils le méconnaissent presque tous. Nous avons un besoin urgent de cyberphilosophie face à la révolution numérique, pour la comprendre, la démystifier, mais aussi en reconnaître les valeurs, la puissance créatrice, mais aussi l’immensité des responsabilités qu’elle nous impose et la solidarité qu’elle éveille. Au-delà de l‘utopie technoscientifique et de ses excès, c’est notre liberté et notre lucidité qu’elle exige à un niveau inédit dans notre histoire humaine.
Lorsqu’on prend conscience de l’influence immense de l’idéalisme platonicien sur l’évolution de l’Occident, alors que ce n’était qu’un phantasme philosophique, à quoi ne devons nous pas nous attendre avec le numérisme, qui est, quant à lui, technoscientifique et donc porteur d’un pouvoir instrumental exorbitant !
Ce sera sans doute, la puissance technologique même de cette révolution numérique, qui nous imposera, par un de ces paradoxes dont l’histoire a le secret, le « supplément d’âme » dont nous avons le plus urgent besoin pour assurer la survie de notre espèce, beaucoup plus encore que des progrès de la science et de la technologie : un profond consensus humain pour nous soumettre aux exigences d’une éthique planétaire.
Hervé Fischer
---------------------------------------------
* C'est Jacques Perret, professeur de philologie latine à la Sorbonne, qui a proposé en 1955 de traduire le mot américain "computer" par "ordinateur", un mot emprunté au vocabulaire théologique. « C’est un mot correctement formé, écrit-il, qui se trouve même dans le Littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l’ordre dans le monde. »
Il n’y manque plus que Dieu. Le numérisme n’a pas manqué de créer une sorte de religion, avec ses communautés virtuelles, telles les églises Apple, Microsoft, Google, Facebook, ou les paroisses Myspace, Youtube, Twitters, Skype, leurs fidèles et leurs infidèles, des codex pour les initiés, une discrimination entre ceux qui sont connectés, sans cesse connectés à ce monde supérieur - les intelligents -, et ceux qui ne le sont pas - les païens, les obscurantistes. Et le posthumanisme nous annonce une sorte de paradis intelligent à venir sous le règne du numérique.
Il est étonnant de constater que le réalisme, né avec la Renaissance, pourtant si instrumental de notre puissance occidentale, n’aura guère duré plus de cinq siècles, un instant en comparaison des milliers d’années d’évolution de notre espèce. Nous n’aimons pas les païens, ni les athées, ni les démystificateurs. Nous voulons des dieux, des intelligences supérieures – aujourd’hui celle du Grand Ordinateur* -, nous avons besoin d’excommunications, de dépendance, de soumission. Nous nous berçons encore d’illusions et de chimères, un doux mélange d’idéalisme platonicien, de magie numérique, avec ses rites, ses initiations, ses célébrations, ses marchands du temple, ses prêtres, ses gourous, ses chamans et les formules de sorcellerie de ses algorithmes. Et dire que nous nous croyons modernes ! Et même postmodernes ! Posthistoriques !
Paradoxalement, seuls les philosophes nous invitent quasiment tous à nous détourner de ce nouvel idéalisme. Ils n’en ont pas encore perçu le pouvoir intellectuel et spirituel. Ils se gargarisent encore de Platon, de ses leurres et de ses fantasmes, sans avoir compris que nous y sommes revenus, étonnamment par le biais de la technologie, comme avait su le comprendre McLuhan. Au nom d’un humanisme vieillot, au nom de la philosophie, ils veulent nier l’importance radicale de la révolution informatique et son impact sur notre civilisation et précisément sur nos idées. Ils se sont trompés d’adversaire. Ils devraient plonger dans le numérisme avec ferveur.
Nous voilà donc confrontés à de grands malentendus, comme il est arrivé si souvent dans l’histoire des idées. Les philosophes ont raison de se méfier du numérisme, mais ils ne le critiquent pas pour les bonnes raisons ; d’ailleurs ils le méconnaissent presque tous. Nous avons un besoin urgent de cyberphilosophie face à la révolution numérique, pour la comprendre, la démystifier, mais aussi en reconnaître les valeurs, la puissance créatrice, mais aussi l’immensité des responsabilités qu’elle nous impose et la solidarité qu’elle éveille. Au-delà de l‘utopie technoscientifique et de ses excès, c’est notre liberté et notre lucidité qu’elle exige à un niveau inédit dans notre histoire humaine.
Lorsqu’on prend conscience de l’influence immense de l’idéalisme platonicien sur l’évolution de l’Occident, alors que ce n’était qu’un phantasme philosophique, à quoi ne devons nous pas nous attendre avec le numérisme, qui est, quant à lui, technoscientifique et donc porteur d’un pouvoir instrumental exorbitant !
Ce sera sans doute, la puissance technologique même de cette révolution numérique, qui nous imposera, par un de ces paradoxes dont l’histoire a le secret, le « supplément d’âme » dont nous avons le plus urgent besoin pour assurer la survie de notre espèce, beaucoup plus encore que des progrès de la science et de la technologie : un profond consensus humain pour nous soumettre aux exigences d’une éthique planétaire.
Hervé Fischer
---------------------------------------------
* C'est Jacques Perret, professeur de philologie latine à la Sorbonne, qui a proposé en 1955 de traduire le mot américain "computer" par "ordinateur", un mot emprunté au vocabulaire théologique. « C’est un mot correctement formé, écrit-il, qui se trouve même dans le Littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l’ordre dans le monde. »
Libellés :
caverne,
cyberphilosophie,
Dieu,
éthique planétaire,
illusions,
intelligence collective,
noosphère,
Platon,
puissance,
utopie
vendredi, décembre 17, 2010
Babel mon amour - mythanalyse des masses
Un monde paradoxal émerge entre les deux pôles de la mondialisation et de la diversité. La Terre est devenue une galaxie de planètes. Nos sociétés ont beaucoup changé ; et nous aussi. Nos vies se jouent entre le culte de l’individu et le pouvoir des masses, entre le sentiment irréductible de l’existence intime et la conscience de l’autre que nous sommes aussi. On me pense, protestait déjà Arthur Rimbaud. Sur le rivage de soi-même, chacun explore ce monde bigarré de l’humain, tout à la fois proche et lointain, éclaté et englobant, à l’image de peintures impressionnistes constituées de petites touches de couleur autonomes juxtaposées, dont les énergies s’unifient à distance.
Les masses sont-elles les nouveaux dieux d’un univers de particules en incessante agitation ? Nos cosmogonies pulsent avec les flux et les reflux des forces de fragmentation et d’unification. Confrontés à des vitesses inédites et aux accélérations du changement, nous construisons, déconstruisons, transformons des liens, des divergences et des projets selon nos instincts de plaisir, de mort et de puissance, mais aussi selon notre désir supérieur d’humanité. Nos solitudes se conjuguent avec nos solidarités. Notre conscience planétaire se fonde sur des abîmes sociaux.
Des masses individualistes
Pour élucider ces paradoxes, il faut évoquer l’histoire. Depuis la rupture mythique de 1789, l’Occident est passé de l’ordre aristocratique à celui de la bourgeoisie, bientôt dominée par les aspirations des classes moyennes. Après la montée des fascismes, les désastres des guerres et des génocides, nous avons connu l’imaginaire libérateur de Mai 68, dont on se demande encore s’il a brillé comme un feu de paille ou fondé des espérances durables.
Nous pensons vivre aujourd’hui dans des sociétés de masse individualistes. Mais existent-elles vraiment ? N’observons-nous pas le recul des collectivismes? Les masses sont-elles des mégaféodalités économiques ou le volant d’inertie de nos inclusions sociales ? Des agrégats déstructurés qui flottent au gré de courants chaotiques, ou le ballet aussi précis qu’imprévisible des bancs de poissons et des volées de perroquets ? Le ventre mou du social ou des représentations créées par la société de l’information dans lesquelles nous projetons nos peurs et nos espoirs ? Réelles ou imaginaires, elles n’en sont pas moins déterminantes. Nées du choc démographique, elles se conjuguent avec la nouvelle puissance des technologies numériques, dont le pouvoir intégrateur et l’apparente apesanteur sociologique ne sauraient nous dissimuler l’atomisation de nos consciences et les fractures sociales.
Existe-t-il une idéologie des masses ?
Les impérialismes et les colonialismes ont fait leurs temps. Destructeurs, ils sont devenus illégitimes. La manipulation des masses et le colonialisme des individus en auraient-ils pris la relève ? Au-delà de ce qu’on pourrait penser comme une fatalité quantitative, sommes-nous dominés par une idéologie des masses ? Quelles seraient ses structures, ses valeurs, ses symboles ? Serait-elle posthistorique ou prétendrait-elle encore invoquer le progrès? De quels mythes fondateurs tiendrait-elle alors sa légitimité ? Du triomphe final du monothéisme universaliste sur les diversités polythéistes, de Dieu sur Prométhée ? Le monde s’occidentalise-t-il ? L’Occident se banalise-il ? Nous pensons les synchronicités comme des écosystèmes.
Les yeux tournés vers les vitraux cathodiques de nos sociétés écraniques, nous situons imaginairement les serveurs informatiques dans les nuages du cloud computing, comme un nouveau dieu du ciel et nous en remettons à l’intelligence artificielle comme jadis à la providence. Comment concilier le vieil idéalisme de l’unité avec le nouveau mythe de la diversité sur terre ? Et celui-ci avec l’égalitarisme démocratique, incompatible avec la loi du plus fort qu’implique la biodiversité de la nature ? Mieux vaut réécrire le mythe de la Tour de Babel comme le drame des hommes aux prises avec eux seuls. Mais peut-on composer une sonate à deux, à trois, à mille pianos ?
La nature elle-même a beaucoup changé en deux siècles. De romantique et intimiste, elle est devenue aujourd’hui politique et scientifique. Célébrée en raison tout à la fois de sa puissance et de sa fragilité, elle cède pourtant aux espoirs de l’artifice.
Le narcissisme n’a plus guère cours. Le sujet semble se banaliser dans un monde d’objets qui s’annoncent intelligents et connectés. Le corps est-il désormais obsolète, comme l’affirment les posthumanistes, alors que nous en célébrons tant les icônes ? L’homme devient-il le grand absent de ce monde technoscientifique, ou est-il le seul centre pensable d’un univers infini? Le culte des idoles médiatiques érigées en demi-dieux vise-t-il à compenser les frustrations de nos anonymats individuels?
Nos structures mentales sont déstabilisées. Nous délaissons le mythe de la profondeur de la pensée et de l’inconscient individuels pour celui de la surface et de la navigation numérique. Nous avons abandonné la causalité linéaire pour l’arabesque heuristique des liens. Nous explorons les lois du chaos, les logiques floues, et admettons le principe d’incertitude. Nous avons renoncé aux utopies politiques du XIXe siècle pour proclamer celle de la technoscience, devenue le moteur de notre évolution. Nous célébrons l’interactivité et le web 2.0, qui semblent symboliser la créativité humaine dans l’uniformisation des masses.
Nous vivons de plus en plus dangereusement
Le mythe de la diversité et la multiplication des rationalités qu’il consacre nous annoncent-t-ils le retour des barbares et de l’obscurantisme ? Ou serons-nous capables de nous les approprier ? Les libertés individuelles seront-elles laminées par les logiques des mégastructures et les menaces des terrorismes ? La puissance des masses sera-t-elle battue en brèche par les nationalismes identitaires, les multiculturalismes et les nouveaux tribalismes ? Les égalitarismes résisteront-ils au néo-libéralisme darwinien? La montée des intégrismes et la multiplication des sectes auront-elles raison de la généralisation de l’athéisme ? L’émotivité des flux de cultures de plus en plus liquides bannira-t-elle l’arrêt sur image et le temps de la pensée critique?
Le futur se dilue dans les arabesques de l’événementiel. La mémoire du passé est orpheline. La déréliction semble se répandre comme une tâche d’huile. Confrontés à notre nouvelle puissance instrumentale, nous vivons de plus en plus dangereusement. Le désenchantement postmoderne cèdera-il face au retour du désir de progrès ? Le nihilisme face aux promesses du numérique ? Ou le cynisme, la violence et l’exploitation humaine l’emporteront-ils sur les exigences d’une éthique planétaire ?
Le choc soudain et extensif de la diversité, et son culte en contradiction avec la dynamique uniformisatrice des masses, ont provoqué une réactivation du mythe de l’unité, la montée des intégrismes, et cette étrange dépendance aux médias sociaux que nous observons. Nous sommes de moins en moins modernes. Quels mythes saurons-nous identifier, réactiver, transformer ou inventer pour reprendre le contrôle de notre destinée ? Entre l’ombre et la lumière de l’humanité, l’avenir est en suspens.
Hervé Fischer
dimanche, février 28, 2010
Les théories sont des fictions
Le romancier évoque sans insistance, il dit moins pour suggérer plus, il use de l’ambiguïté, du non dit, se contredit, cultive le flou, étale sa mauvaise foi, ment comme un arracheur de dents, pour donner à son récit l’épaisseur, l’obscurité, la puissance de la vie. Il mystifie pour être vrai. Tout à l’opposé, l’essayiste tente de tout dire, de mettre à nu, d’expliciter ce que cache l’obscurité d’un cliché, il met en lumière l’incertitude de l’évidence, il articule les raisons implicites, il cherche la cohérence, il démystifie, pour mettre la vérité à plat et convaincre son lecteur de la pertinence aigue de ses affirmations. Voilà donc deux écritures opposées, la romanesque et la théorique, qui adoptent deux stratégies inconciliables. Ce qui fait généralement du romancier un mauvais théoricien, et de l’essayiste un mauvais romancier. Il y a pourtant de grandes exceptions. Certainement pas Sartre, même si sa célébrité lui a valu une attribution de Prix Nobel, mais Camus, Umberto Eco. Peut-être le degré zéro de l’écriture de L’étranger s’y prêtait. Peut-être les intérêts intellectuels d’Eco pour la langue et la sémiologie aussi. Mais poussons le questionnement un peu plus loin. Lorsque j’affirme que les théories sont des fictions – ou des romans -, je souligne évidemment plusieurs aspects importants de l’écriture théorique. Essayons de les décliner ici :
-Toute théorie est un récit, qui met en scène des acteurs, des objets, un contexte, des buts, une conjugaison des verbes qui introduit le temps de l’action. Ce récit a une structure familiale, qui met en jeu le père, la mère, le fils, la fille, et rend ainsi l’explication familière, c’est-à-dire semblable à une structure que nous admettons parce qu’elle nous est co-existentielle.
- Tout concept, même le plus abstrait, est un concept-image, dont le sens trouve ses racines dans l’évocation qu’il recèle. Ainsi, «s’orienter», c’est se tourner vers la lumière qui se lève et fend l’obscurité. Le sens est une direction ; comprendre, c’est lier, etc. Cette cause là est entendue, c’est-à-dire vraie parce que souvent redite.
-Toute pensée, même la plus théorique, est métaphorique. Nous pensons par images que nous agrégeons selon des liens familiers : cela rejoint nos structures mentales biologiques, celles que nous avons développées dans nos rapports familiaux avec le père et la mère, ceux qui savaient. Je l’ai écrit dans Mythanalyse du futur, il y a déjà dix ans (*), toute théorie est un roman des origines, que chaque penseur réécrit dans son style et selon ses motivations contextuelles.
- Toute élaboration théorique est une tentative de prise de pouvoir : sur l’autre, sur nos angoisses, sur nous-mêmes. Elle nous libère ou nous donne un avantage social. Elle comporte donc un investissement psychique personnel. Cette motivation intime est-elle étrangère aux exigences d’objectivité ou de neutralité de la connaissance ? On l’a dit à satiété. Mais en fait, elle est dans la nature même de notre désir de connaissance, dans notre exigence de dévoilement (encore une image qui ne laisse pas de doute sur notre désir). Les batailles d’arguments auxquels se livrent les théoriciens, qu’ils soient physiciens, historiens, économistes, écrivains ou peintres avant-gardistes, nous confirment la présence de ces enjeux constants de pouvoir. Il faut avoir raison de l’autre !
Aucune théorie n’échappe à ces déterminants que la mythanalyse essaie de mettre en lumière. La mythanalyse n’y fait, bien sûr, pas exception. Elle est une démarche obsessive de lumière et de libération. Elle veut enfanter, mettre au jour, c’est-à-dire à la lumière et nous apporter la délivrance, au sens même de l’accouchement, qui est aussi l’é-ducation sociale (la voie de sortie) de l’in-fans (celui qui n’a pas encore la parole et donc n’est pas encore un adulte). On n’en finirait pas de rappeler toutes les étymologies significatives de notre cheminement sur la voie de la connaissance. Quel récit ! Que de promiscuité ! La scène familiale de la naissance demeure le mythe élémentaire, biologique, sur lequel se fonde la mythanalyse. Ce que la mythanalyse recherche, c’est l’analyse du récit de notre origine, capable de révéler le sens de nos métaphores et finalement de nos imaginaires, à la fois individuels et collectifs – individuels parce que collectifs. Dire que toute théorie est une fiction, un roman, c’est seulement rappeler ce que nous tenons tellement à oublier, qui est l’origine familiale et biologique de nos efforts théoriques, ceux que nous déclarons les plus objectifs.
Hervé Fischer
(*) Mythanalyse du futur, www.hervefischer.net (2000).
Libellés :
fiction,
myhe élémentaire,
roman,
romanthéorique,
théorie,
théorie-fiction
lundi, septembre 07, 2009
La boîte de Pandore numérique

Voilà 40 ans, depuis le 2 septembre 1969 qu’est né l’internet. En fait, ce ne fut encore que la communication, fort laborieuse et limitée, entre deux ordinateurs reliés par un câble de 4,50 m de longueur, à l’université Californie à Los Angeles. Puis on a élargi les distances avec les universités de Stanford, Santa Barbara et l’Utah. On peut discuter la date, souligner le rôle de Licklieder, du MIT, qui eut la vison de l’importance de ces futurs réseaux de communication. On doit citer Leonard Kleinrock, qui théorisa dès 1961 la commutation et la transmission d’informations par « paquets », Paul Baran et Douglas Engelbart, dont nous allons reparler. Les auteurs sont plusieurs. Ce fut une histoire militaire autant qu’universitaire, comme le rappelle la signification d’Arpanet, créé par la Defense Advanced Research Projects Agency pour assurer la sécurité de ses communications en temps de guerre grâce à un réseau (Network) décentré multipolaire, qui deviendra notamment le MILnet (Military Network).
Voilà 40 ans aussi, que Douglas Engelbart a inventé au Stanford Reearch Institute la fameuse souris dont nous nous servons encore aujourd’hui pour déplacer le curseur sur nos écrans d’ordinateur. Il n’en reçut aucun dividende financier, mais le SRI vendit le brevet à Apple qui a donné à ce petit rongeur à queue numérique l’expansion que l’on sait. On attribue aussi généralement à Engelbart le concept d’intelligence collective, dont il a exposé la philosophie dans Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework.
Aujourd’hui, seulement deux générations plus tard, alors que nous comptons plus de 1,3 milliards de personnes connectées sur la planète à l’internet grâce au Web et au sans fil, il est bon de rappeler que c’est avec un câble de 4,50 m que cela a commencé. De petites inventions peuvent avoir un impact extensif sur toutes nos activités en quelques décades. C’est cela qui caractérise l’évolution de notre espèce et l’accélération que nous expérimentons à l’époque actuelle. L’âge du numérique commence à peine, mais il nous oblige déjà à changer drastiquement nos comportements et réinterroge nos valeurs. Saurons-nous maîtriser le choc du numérique? La boîte grecque de Pandore que nous avons ouverte, ou la pomme, son équivalent biblique, sont aujourd’hui numériques, nous donnant accès à plus de pouvoir, plus de connaissance, plus de conscience planétaire, plus de bien – le progrès non seulement technique mais aussi humain – et plus de mal aussi. Faut-il diaboliser une fois encore cette pomme numérique et accuser le Satanford Research Institute, ou assumer les responsabilités éthiques qui viennent avec Prométhée et avec la conscience? Est-il pertinent de parler d’une « augmentation de la conscience collective » ou d’une « intelligence collective augmentée »? Souhaitons que l’utopie se réalise. C’est manifestement l’utopie la plus en vogue aujourd’hui parmi les philosophes du numérique les plus optimistes. Mais cela demeure encore à démontrer, tandis que les raisons d’en douter augmentent elles aussi. Le défi nous confronte à nous-mêmes. Il n’est plus religieux, il n'est pas technique. Il est éthique. Et planétaire.
samedi, mai 16, 2009
Evolution et création

En cette année Darwin où nous célébrons le 200e anniversaire de sa naissance et le 150e de «De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle», nous nous devons de reconnaître que la théorie darwinienne de l’évolution naturelle constituait une formidable rupture par rapport à la croyance en Dieu qui dominait alors l’Occident.
Cet hommage admiratif étant rendu, force est de constater que sa théorie demeure fondamentale pour comprendre l’évolution du règne animal, mais ne permet pas d’expliquer le développement de l’espèce humaine. En comparaison des autres mammifères, nous avons connu une évolution si rapide qu’on ne peut plus parler d’adaptation et de sélection naturelle, mais qu’il faut considérer des mutations dramatiques et répétées. À plusieurs reprises déjà j’ai souligné qu’il est nécessaire d’envisager une Loi de la divergence, qui est le contraire de la Loi de l’adaptation (1). Le génie de Darwin lui-même en constitue un exemple indéniable, en un temps où Dieu et la création divine – le créationnisme – s’imposait à tous. La transformation rapide et majeure de l’espèce humaine, par rapport aux autres espèces vivantes, s’est faite par mutations biologiques qui ont moins répondu à des contraintes extérieures, écologiques, qu’à des projets spontanés du cerveau humain. Si nous nous référons à l’histoire récente, nous constatons que l’invention de la roue, ou la maîtrise du feu, de l’électricité ou du nucléaire ont résulté d’un développement des capacités cérébrales conceptuelles de notre espèce. Sans doute ce pouvoir n’est-il pas unique. Plusieurs espèces animales conçoivent aussi des outils. Le castor construit des barrages, les fourmis et les abeilles créent des sociétés industrieuses ; et nous pourrions citer mille exemples qui contredisent la différence radicale de nature entre l’homme et l’animal affirmée à tort par tant de philosophes et d’anthropologues, célèbres, mais ethnocentristes. De fait, l’homme procède systématiquement par divergence. Son histoire le démontre. L’invention grecque du rationalisme, les monothéismes, les théories scientifiques, les révolutions sociales, l’histoire de la peinture, celle des technologies et l’invention du verre, du béton ou du plastique. On pourrait y consacrer des milliers de pages admiratives. Ce n’est jamais par adaptation que l’histoire humaine procède, mais par volonté de rupture, au risque que leurs auteurs soient d’abord marginalisés, honnis, martyrisés, tués, ou se condamnent eux-mêmes à la folie, tant l’écart qu’ils doivent assumer solitairement est démesuré. La plupart des grandes idées qui ont fait notre histoire ont été d’abord condamnées avant d’être admises, puis de s’imposer aux majorités qui s’y sont adaptées.
Bien que nous soyons des animaux, incluant des animaux philosophes ou des mathématiciens animaux, nous sommes capables de diverger des lois connues de la nature, comme si nous en étions une tête chercheuse, une intelligence avancée, un organe créatif capable d’en accélérer la transformation en inventant des scénarios alternatifs. Notre espèce est fascinée par l’artifice, au point où elle semble se séparer audacieusement de la nature. La loi de la divergence est le fondement même de la création – que ce soit celle que la Bible attribue à un dieu, ou le pouvoir de création que nous devons nous reconnaître à nous-mêmes (2).
L’espèce humaine évolue au rythme des divergences créatrices de ses imaginations, de ses idées, de ses projets, de ses nouvelles logiques, de ses innovations technologiques, de ses projections dans des utopies. Sans cela, nous n’aurions pas inventé les avions. Et chaque fois qu’il y a un saut, l’être humain, voire le groupe, voire l’espèce humaine elle-même mettent en jeu leur survie. Ainsi, l’énergie nucléaire, ou la seule transformation industrielle de notre environnement mettent en péril la survie de notre planète. Faut-il demeurer darwinien et croire, comme on l’a dit parfois, que la nature vise ainsi à éliminer l’espèce humaine pour assurer sa propre survie ? On ne saurait en tout cas affirmer alors que la loi darwinienne s’applique à l’espèce humaine. Et c’est bien ce que je veux souligner. Car en devenant créatrice, notre espèce prend le risque radical de sa propre extinction.
Dès le moment où l’homme descend des arbres et adopte une posture verticale pour se déplacer, à la différence des autres primates, puis spécialise son évolution en développant des capacités cérébrales qu’on n’observe pas chez les autres animaux, il est clair que cette divergence se traduit par des mutations mentales, psychologiques, sociales qui s’inscrivent biologiquement dans le corps (colonne vertébrale, cerveau, habileté manuelle, etc.). Irions-nous jusqu’à parler alors de transformations génétiques ? Oui : l’évolution de notre corps actuel le confirme. Mais à la différence de Darwin, nous ne l’attribuons pas à une sélection naturelle opportuniste, qui élimine les désadaptés et assure la survie de ceux qui ont des écarts génétiques accidentels devenus utiles. Il s’agit de mutations génétiques résultant de projets humains, d’imaginations alternatives, de conceptualisations de l’avenir, bref d’une conscience et d’une volonté proactive d’évolution. La loi de la divergence diverge donc radicalement de la loi darwinienne. Irions-nous donc jusqu’à penser que les idées peuvent provoquer des mutations génétiques ? On hésite certes à faire le saut avec une telle affirmation, qui fait peur, car elle véhicule aussi la possibilité de ses effets pervers : toutes les idées ne sont pas bonnes. Allons-nous admettre que le déisme, les superstitions, le racisme, le fascisme, l’injustice, l’exploitation, le sadisme, le crime peuvent créer des mutations génétiques ? Et inversement faudrait-il admettre que l’inclination au crime serait due à un gène ? L’idée va manifestement plus loin que nous ne sommes prêts à l’accepter. Cependant il est simpliste de parler seulement de génétique, les gènes ne constituant certainement qu’un niveau élémentaire («squelettique») de description des déterminants de notre évolution et de nos comportements. Ainsi, lorsque nous admettons la légitimité des orientations sexuelles, il n’est pas nécessaire d’invoquer une différence génétique, là où des diversités hormonales où socio-culturelles suffisent sans doute à expliquer des différences de comportements. Par prudence par rapport au vocabulaire scientifique contemporain, et pour éviter de fausses polémiques, nous nous limiterons à affirmer que les idées et l’imaginaire humains (ce sont deux déclinaisons de la même activité cérébrale, soit plus conceptuelle, soit plus imagée) créent des mutations biologiques de l’espèce, qui déterminent, voire accélèrent son évolution.
J’en donnerai aussitôt un exemple très significatif. Quoiqu’en ait dit Jean-Jacques Rousseau en un temps d’utopie libératrice, il est évident que l’éthique n’existe pas dans l’état de nature. C’est la loi de la jungle ou loi du plus fort qui y règne. Qu’importe la violence ou la modération dont la nature fait preuve, les valeurs du bien et du mal ne s’y rencontrent pas. L’éthique est une invention humaine, spécifique à notre espèce, et sans doute récente dans notre évolution. Or l’éthique, telle que nous la concevons, et telle que nous l’appliquons – encore trop peu et trop rarement – constitue une divergence radicale par rapport à la loi darwinienne de l’évolution naturelle. Elle implique que nous ayons de la compassion pour les faibles, les malades, les infirmes et tentions de les protéger, voire de les sauver, au risque même qu’ils se reproduisent et transmettent leurs gènes qui constitueront éventuellement un maillon faible dans notre chaîne évolutive. La loi de l’adaptation naturelle voudrait au contraire que nous les éliminions, comme s’y est employé le nazisme dans sa politique eugéniste. D’ailleurs, les fascismes ne se contentent pas de mettre en prison, mais s’assurent d’éliminer les individus porteurs d’idées différentes, comme s’ils avaient des gènes dangereux pour l’avenir. L’invention de l’éthique et nos efforts communs pour en généraliser le respect sont inexplicables par la loi darwinienne de l’évolution des espèces ; elle en sont même la négation évidente. Pourtant, nous affirmons – au risque de passer pour des naïfs marginaux – son importance pour le progrès de notre espèce, voire pour sa survie.
Et voici un deuxième exemple. Il est de plus en plus évident que la technoscience est aujourd’hui en compétition directe, voire en opposition déclarée, avec la nature en tant que nouveau moteur de l’évolution de notre espèce. Même sans succomber aux discours des gourous utopistes, nous allons devoir admettre de plus en plus que l’invention des technologies numériques déclanche une révolution anthropologique aussi marquante que la maîtrise du feu en son temps (3). L’âge du numérique dans lequel nous entrons, et dont nous ne comprenons encore que les prémisses, annonce aussi ce qu’on peut appeler l’anthropocène : l’âge de l’homme. Plusieurs spécialistes veulent dire ainsi que notre planète porte désormais la signature de notre espèce, dont l’activité transforme désormais les paramètres plus que ne le font la géologie, la météorologie et tous les autres déterminants naturels. Les technologies numériques nous permettent de développer de nouveaux paradigmes : la nature, la vie, l’intelligence et la mémoire artificielles. Nous passons de la domination de la biosphère à des utopies numériques. Je ne suis certes pas de ceux qui proposent de généraliser la loi de Moore (la puissance, la mémoire et la vitesse de nos ordinateurs doublent tous les dix-huit mois) à l’évolution humaine. Mais nous pourrions affirmer que ce n’est plus Dieu, ni la Nature qui expliquent notre évolution. Le numérique remplace la Nature aussi bien que Dieu. Devons-nous mettre une majuscule au numérique et en faire une nouvelle religion, comme plusieurs prêcheurs actuels ? Dieu nous garde de toute religion et de leurs faux prophètes, même s’ils sont reconnus et célébrés à l’envi. Les êtres humains faibles d’esprit ont toujours tendance à renoncer à leur liberté de pensée et à leur dignité, pour s’en remettre à une intelligence supérieure, qu’elle soit naturelle, divine, ou aujourd’hui artificielle.
Mais il serait tout aussi ingénu de nier que le numérique provoque aujourd’hui une transformation accélérée de nos structures mentales, psychiques, cognitives et sociales. Nous passons manifestement de la rigidité à la flexibilité de la pensée, du raisonnement linéaire à la configuration en arabesque, de la causalité à la sérendipité. Notre syntaxe est devenue associative, comme les idéogrammes chinois. Dans nos bibliothèques virtuelles, nous avons remplacé nos tiroirs à fiches alphabétiques par des moteurs de recherche traquant à haute vitesse les hyperliens. Les classifications aristotéliciennes par catégories et ensembles ont cédé la place aux liens et aux hyperliens. Nos modes de communication individuelle et sociale sont en pleine mutation eux aussi. Nous passons d’un monde basé sur le temps lent et répétitif, sur la mémoire et l’expérience, à un monde caractérisé par la fragmentation, la vitesse et l’agitation. Ce sont certes de nouveaux concepts psychologiques, sociaux et physiques difficiles à cerner et manipuler du point de vue épistémologiques, mais nous devons relever ce défi. Nous entrons dans le postrationalisme (4). Nous pouvons parler d’un mouvement social brownien des particules, tout autant que de société de masses et de globalisation. C’est ce que j’ai appelé la conscience impressionniste de notre image du monde et de notre conscience sociale. Dans ce désordre, voire dans ce chaos, c’est par association d’individus (petits groupes) et par association d’idées, que nous pensons et que nous vivons, donc par liens et hyperliens. À cet égard, le web n’est pas seulement un exemple évident de notre nouveau mode de pensée et de communication : c’est la métaphore même de notre monde contemporain, si paradoxal : écranique, irréel et trop réel, fragmenté et global, chaotique et contraignant, ludique, euphorique et incontrôlable, où nous tentons de construire du sens et des valeurs et de nous orienter au hasard de mos navigations. S’orienter n’est aussi qu’une métaphore : c’est regarder vers l’orient, du côté où la lumière se lève. Et nous sommes devenus dépendants de la lumière bleutée de nos écrans.
Nous vivons de plus en plus sur une planète hyper. Il nous faut passer de la solitude à la solidarité des liens. Nous redécouvrons ainsi le sens de la morale confucéenne, celle des liens sociaux, qui fait écho aux liens des idéogrammes. Nous prenons ainsi conscience de la nécessité d’une éthique planétaire. Une éthique qui est la base de l’hyperhumanisme auquel nous aspirons et qui devient plus important que la technoscience elle-même comme moteur d’évolution de notre espèce – et sans doute même pour sauver notre planète et notre espèce de l’auto-destruction. Je n’ai pas de doute que la technoscience va poursuivre glorieusement sa lancée, selon sa propre logique de compétition intellectuelle, commerciale et politique. J3e n’ai donc pas d’inquiétude pour elle et il n’y a pas lieu de la défendre, du moins dans la pensée occidentale. Il n’en est pas de même de la morale planétaire, qui a tant de mal à s’imposer dans les esprits. En évoquant une planète hyper, je dis hyper tout à la fois pour souligner l’augmentation de la conscience humaniste dont nous avons besoin et pour reconnaître l’importance des hyperliens comme structures mentales, psychiques, cognitives et sociales.
En ce sens, le web n’est pas qu’un instrument, ni seulement une métaphore pour penser le monde. Il devient aussi un laboratoire populaire, partagé, d’informations, d’échanges, de solidarités, de conscience et d’innovation. Voilà une technologie qu’on pourrait qualifier de triviale, et qui constitue pourtant une divergence majeure en soi ; plus encore : elle devient un outil de progrès humain et finalement d’hyperhumanisme.
Le génie de Darwin était grand. Aujourd’hui, il penserait l’évolution en numérique et en création humaine.
Hervé Fischer (5)
_________________________________________
(1). Voir La société sur le divan, vlb, Montréal, 2007.
(2 ) Voir Nous serons des dieux, vlb, Montréal, 2006.
(3) Voir Le choc du numérique, vlb, Montréal, 2001.
(4) Voir La planète hyper. De la pensée linéaire à la pensée en arabesque, vlb, 2003.
((5) Cette conférence a été donnée lors du Webcom, le 13 mai 2009.
Libellés :
Darwin,
éthique planétaire,
Évolution,
hyperhumanisme,
hyperliens,
liens,
mutations,
numérique,
solidarité,
technoscience
lundi, avril 13, 2009
La dynamique constructive des rêves

Comment ne pas être interpellé par le désordre des rêves, qui surprennent sans cesse le dormeur. C’est bien notre cerveau, le même cerveau, qui improvise les story-board de nos rêves, ses effets de surprise et nos réactions d’acteur. D’où tient-il ce pouvoir évident de se prendre lui-même au dépourvu à chaque instant par des rencontres, des épisodes, des dénouements qui nous paraissent totalement inattendus, incongrus ou puissamment créatifs? Nous vivons nos rêves comme la vie, selon des scénarios qui surgissent sans préavis et auxquels nous tentons de nous adapter. Mais les rêves apparaissent encore plus indépendants de notre contrôle. Nous avons le sentiment qu’ils sont créés par un autre que nous-même, comme si le rêveur se dédoublait en un metteur en scène habile à nous surprendre et un acteur désemparé.
Sommes-nous aliénés à nous mêmes dans nos propres songes, manipulés par des esprits malins? Il ne faut pas s’étonner que la tradition humaine les ait donc souvent interprétés comme des messages des dieux, qui profitent de notre sommeil pour communiquer avec nous. Comment notre propre cerveau peut-il disposer d’une telle autonomie inventive par rapport à nous-même et inventer deux rôles simultanés? D’où tient-il cette dynamique infatigable de construction narrative? Comment se construit l’écart entre notre conscience de rêveur et les événements qui nous assaillent dans le sommeil?
Ces questions m’ont longtemps laissé sans réponse. Au-delà de la littérature ésotérique, je n’ai pas trouvé d'explication dans mes lectures. Mais j’ai toujours eu le sentiment que la compréhension de ce phénomène si étrange serait de grande importance pour analyser aussi notre fonctionnement cérébral diurne.
Et peut-être l’insistance que j’y ai mis a-t-elle favorisé une intense activité de rêveur, que je me suis plu à interrompre souvent par des réveils intempestifs qui me plongeaient chaque fois dans cette même stupeur : le sentiment absurde qu’un autre que moi-même se jouait malignement de moi dans mes rêves.
Les psychanalystes invoquent une syntaxe et des « logiques de l’inconscient », hétérogènes à notre logique rationnelle de vie diurne, qui fonctionneraient à notre insu dans le rêve, en fonction de notre mémoire, de nos inquiétudes, de nos désirs, et nous soumettraient donc à une rencontre onirique, voire à une confrontation avec nous-mêmes (moi et surmoi. Ils appuient donc leurs interprétations du subconscient sur le récit des rêves. Encore faut-il pouvoir expliquer la gestation cérébrale des rêves, son autonomie spontannéiste et ses effets de surprise conçus en amont et aux dépens de la conscience du dormeur. Devrait-on dire que lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent?
L'apparente autonomie du rêve
Sans même recourir à une pratique clinique, plusieurs déductions s’imposent d’elles-mêmes.
La première, c’est que la conscience du rêveur ignore à quelles surprises le cerveau va le soumettre subrepticement. Autrement dit, la conscience humaine, de même que la mémoire ou la perception, dissimule, ignore ou censure beaucoup plus d’informations qu’elle n’en donne à connaître. Une conscience intégrale de tout ce qui entoure un être humain, une mémoire immédiate de tout ce qu’un être humain peut se rappeler, rendrait la vie impossible. On le sait : ne remonte à la conscience que ce qui est utile à la survie ou pertinent par rapport à la psyché. C’est manifestement ce même mécanisme de sélection et d’obturation de la conscience qui opère dans le rêve, mais beaucoup plus flexiblement.
La seconde déduction, c’est que les structures associatives et les règles syntaxiques de la conscience ont un pouvoir de construction du rêve beaucoup plus rapides et inventives que la conscience que nous en avons. Ce fonctionnement autonome est manifestement le même pour le cerveau que pour les autres organes du corps humain : le cœur, le foie, l’estomac, les poumons, etc. La gestation des idées, les connections qui se nouent, les conceptualisations qui se précisent en amont ou indépendamment de notre conscience sont non seulement sont très rapides, mais aussi beaucoup plus foisonnantes et multiples que le résiduel que nous en retenons. Nous sommes loin d’être conscients de toutes les idées, intuitions, associations d’idées et d’images que notre cerveau génère. À cet égard encore, les arguments d’utilité pour la survie ou de sélection selon nos intérêts psychiques prévalent.
La troisième déduction, c’est que les structures élémentaires d’association ou d’enchaînement des idées et d’agrégation des images constituent une matrice puissante du cerveau, en constant fonctionnement, à l’état de veille comme dans le sommeil, qui activent sans cesse des connections neuronales, que nous sélectionnons dans la vie diurne consciemment, et dans le rêve inconsciemment.
De ce moulin à images et à idées, mu par la centaine de milliards de neurones (10 puissance 11) stimulant les synapses du cerveau, notre conscience ne capte qu’un mince affleurement filtré par la grille sélective de nos besoins et de nos sentiments les plus immédiats. Toutes ces connections se sont construites durablement au moment où l’enfant élabore sa perception et son interprétation du monde. Elles sont donc élémentaires et puissantes comme une matrice biologique du cerveau humain. Le cerveau, comme nos autres organes, ne cesse de fonctionner, quasiment dans un état neurovégétatif, et de produire des milliers de connections synaptiques toujours disponibles pour être réactivées par la mémoire, par l’intelligence ou par le rêve. Ce bouillonnement souterrain – je choisis ici la métaphore de la profondeur – est puissant et chaotique, comme le continent irrationnel sur lequel surfe notre conscience diurne. C’est ce que nous suggère le processus du rêve. En recourant à une autre métaphore, celle de la lumière, je dirai que le rationnel est un léger glacis lumineux de la plus grande importance vitale, stratégique et humaniste sur un océan neuronal obscur et en constant remous.
La conscience ne sait pas qu'elle rêve
La quatrième déduction, c'est que face au surgissement des associations obscures d'images et d'idées que lui présente le cerveau, la conscience du rêveur se présente comme une conscience semi-diurne, comme un semi-éveil, favorisant le réflexe de tenter de reprendre le contrôle sur le spontanéisme pulsionnel, qui nous apparaît comme un désordre de connections existantes.
Allons plus loin. Le rêveur a le sentiment d'être éveillé. Sa conscience ne sait pas qu'il rêve lorsqu'il est confronté à diverses situations de routine, agréables ou cauchemardesques dans ses rêves. Comment est-il possible que la conscience se trompe elle-même? Comment se fait-il qu'elle soit à ce point trompée par l'irréalité du rêve? Faudrait-il croire que la conscience en veille soit elle-même trompée au même degré par la réalité et que la vie n'est qu'un rêve - ou un cauchemar? "Mords-moi pour que je sois sûr de ne pas rêver..." La différence entre le rêve et la réalité peut paraître infra-mince. Comment établir la distinction avec certitude? Cela semble impossible! Au coeur du rêve le rêveur croit tout autant que l'homme éveillé à la réalité de ses sensations, de ses émotions, des ses stratégies d'action. Les rétroactions et les surprises semblent tout aussi réelles dans les deux situations. Cette problématique a souvent été évoquée dans la littérature philosophiques aussi bien qu'onirique. On notera cependant que les émotions, les angoisses, si non les plaisirs sont plus forts, se bousculent à un rythme plus rapide dans le rêve que dans la réalité habituelle. Peut-être pourrait-on dire que dans le rêve les émotions créent une réalité plus intense, plus dramatique. Tandis que dans l'état de veille la réalité usuelle crée plus lentement des émotions. La gestation est inverse et son rythme différent.
Peut-on dire que ce qui distingue le rêve de la réalité ce serait la forte contrainte de la logique et la stabilité des perceptions dans la réalité ordinaire, alors que dans le rêve ordinaire la logique est constamment bousculée, surprise, dans des situations successives volatiles. Logique et stabilité seraient deux attributs usuels de la réalité, que le rêve ne respecte pas. Il y aurait finalement une différence de degré et non de nature entre l'éveil et le rêve? Comme dans le cas de la maladie mentale par rapport à la lucidité du principe de réalité? De l'effet d'une drogue par rapport la conscience "normale"?Nous savons bien que non. Mais en quoi finalement consiste cette différence et sa crédibilité? Quelles "normes" définissent la "normalité" et toutes ses variations? Devrait-on se résoudre à se contenter d'un descriptif? D'un cahier des charges? Le policier demande au conducteur dont il soupçonne l'ivresse de marcher sur une ligne droite. Ne peut-on pas faire mieux dans la distinction entre la conscience que nous avons de la réalité et la conscience qui croit son rêve réel?
Il y a là une problématique qui appelle à des recherches persévérantes.
L'écrivain Jean-Paul Rolland, en traitement dans un Centre de soins psychiatriques de La Chesnaye, près de Paris, écrit dans la Lettre à Mathilde, ou LA MAIN DE DIEU:
Je cherche l'escalier de marbre blanc et mon imagination fiévreuse monte pas à pas jusqu'au
premier étage; silencieusement j'ouvre les mille portes prestement...
QUELLE DÉCONVENUE !
Que les Indiennes sont frigides et peu loquaces, j'ai rencontré quelques entrejambes,
quelques formes intéressantes... mais tout ça n'étais pas sérieux... je cache encore quelques
dessins dans mes tiroirs de fabrication artisanale... *
L'auteur écrit, il choisit ses mots; il est conscient du pouvoir de son imagination et des mots qui en créent l'illusion. Mais ce sont des expériences réelles de situations irréelles qu'il évoque. Comment fait-il, comment faisons nous ce que nous pourrions appeler "la part des choses"? Peut-on comparer les mécanismes du rêve, ceux de la maladie mentale et ceux de l'intoxication par une drogue? Je n'en doute pas. Mais le rêve n'est pas l'effet du molécule chimique. La maladie mentale l'est-elle? Les psychiatres le pensent. Les psychanalystes non.
Ce sont là des observations et des questions de la plus grande importance sur le fonctionnement du cerveau humain.
Hervé Fischer
* Jean-Paul Rolland, La Lettre à Mathilde, ou LA MAIN DE DIEU, 2009, édition Petite Capitale, Paris, p. 116
Libellés :
activité cérébrale neurovégétative,
désordre,
irrationalisme,
rationalisme,
rêve,
synapses
mardi, février 24, 2009
Mythanalyse du capitalisme III
3 -Du féodalisme à la démocratie économique
Nous sommes attachés à la démocratie politique et l’avons consolidée peu à peu dans plusieurs pays. La démocratie est un mythe actif de fondation de nos sociétés occidentales actuelles. Il est laïc et égalitariste. Il prévaut en politique, mais le monde financier l'ignore ou le rejette encore pour faire prévaloir ses privilèges archaïques. La justice appartient à cette même constellation mythique de la démocratie. Elle est réaffirmée constamment et encore plus souvent bafouée. Nous rencontrons là, cependant les deux mythes sur lesquels repenser et réorienter le capitalisme.
Mais dans ces mêmes pays, dits modernes, nous en sommes encore au stade du féodalisme dans l’économie et les finances. Les terribles effets pervers de ce décalage historique nous apparaissent clairement dans la crise actuelle. L’histoire nous rappelle que les seigneuries du Moyen-Âge, puis les aristocraties qui en sont nées, ont su maintenir leur emprise politique pendant des siècles. Il a fallu des révolutions pour leur arracher leur pouvoir et construire, par à coups, les démocraties politiques actuelles, encore très imparfaites. Il est certain qu’il ne faut pas attendre davantage des princes de la finance et de l’économie qu’ils renoncent aujourd’hui spontanément à leurs privilèges et se réforment d’eux-mêmes. Cela prendra encore de nombreuses turbulences, telles celles de 1929 et de 2008. Et ce sont les institutions politiques élues par les masses qui seules pourront venir à bout de cet anachronisme et de ses conséquences dramatiques. Les petits épargnants d’aujourd’hui sont manifestement les serfs et la chair à canon des rois de la spéculation qui règnent sur notre économie financière, comme jadis les paysans se faisaient systématiquement exploiter par les seigneurs. Le nouveau président américain a posé des gestes symboliques à cet égard en plafonnant les salaires des grands argentiers et chefs des entreprises que l’État a sauvés de la faillite avec l’argent des contribuables.
L’économie néolibérale a montré les mêmes abus de pouvoir qui sévissaient sous le régime féodal du Moyen-Âge: les privilèges exorbitants, l’exploitation des faibles, le secret, le fait du prince, le cynisme, l’arrogance, le racket, la prédation, la violence ordinaire. Ces outrances ont été telles qu’elles ont délégitimisé le capitalisme libéral, comme les excès du socialisme soviétique en ont ruiné les possibles vertus. On pourra établir un parallèle avec 1989 et se demander si ce capitalisme sans retenue, libéré de l’hypothèque du communisme, n’a pas rencontré à son tour, vingt ans plus tard, son mur de Berlin – disons son mur de Wall Street.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les actifs bancaires perdus depuis un an sont évaluées à 2200 milliards de dollars; le président de News Corp a estimé, à l’occasion du Forum de Davos, que 50 000 milliards d’actifs de patrimoines individuels seraient partis en fumée. Aux États Unis, le gouvernement aura, selon les chiffres qui circulent, versé quelques 8000 milliards en moins d’un an pour secourir les grandes banques, les assurances et les entreprises notamment dans le secteur de l’automobile. Et cela n’aurait pas empêché les financiers américains responsables de cette catastrophe d’empocher des bonus de 150 milliards depuis cinq ans. Mieux : en pleine crise, ils ont continué à s’accorder mutuellement des bonus exorbitants directement pris dans les fonds de secours offerts par l’État américain. On a même pu observer la difficulté du président Obama à trouver des collaborateurs de haut calibre ayant acquitté tous leurs impôts. Selon les dernières prévisions du Bureau International du Travail, la crise mettra plus de 50 millions de personnes au chômage dans le monde, pour un total de 80 millions de chômeurs, qui pourrait monter jusqu’à 200 millions si la crise dure – une évaluation officielle qu’il faut multiplier au moins par deux pour avoir un estimation réaliste des sans emplois et par cinq pour chiffrer le nombre des êtres humains vivant dans une extrême pauvreté. La dérégulation, un endettement généralisé et une consommation effrénée, l’économie imaginaire et les folies financières des États-Unis nous ont conduit au seuil de la déraison et de turbulences sociales et politiques qui pourraient aggraver encore la situation mondiale.
Bien sûr, la solution ne consiste pas à diaboliser le capitalisme, qui prône la liberté d’entreprendre nécessaire à la création de richesses, et qui demeure assurément la moins pire des idéologies. Mais encore faut-il revenir à son esprit fondateur ou, l’adapter à l’éthique actuelle des classes moyennes. Alan Greenspann, lorsqu’il était président de la Réserve fédérale américaine, avait souligné les risques d’une « exubérance irrationnelle » de l’économie. Et tandis que le Président Obama dénonce la cupidité "honteuse" de plusieurs financiers et entrepreneurs nord-américains, il est bon de rappeler ces mots de Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme: "L'avidité du gain sans limite n'a rien à voir avec le capitalisme, et encore moins avec son esprit. Le capitalisme s'identifierait plutôt à la domination, à tout le moins à la modération rationalisée de cette pulsion irrationnelle". Et il souligne que ce capitalisme repose sur une attitude pacifiste favorisant les échanges, plutôt que sur la conquête, l'exploitation, le cynisme et la violence. Il souligne que c'est son éthique qui a d'abord fondé son succès. Autrement dit, si nous voulons en finir avec les prédateurs et les escrocs du capitalisme déréglé, les justiciers et les Robin des bois ne suffiront pas à la tâche, qui est colossale. Il faut remettre à l’ordre du jour et instituer un certain rationalisme économique, avec les mêmes exigences qui prévaut dans les règles de la démocratie politique. La démocratie ne peut pas être seulement politique. Elle doit aussi être économique et financière. Si non elle n’existe pas réellement.
Certes, nous savons qu’une volonté excessive de rationalisme économique conduit à des effets pervers. Le socialisme économique qui ne dit pas son nom, comme en France, et les excès bureaucratiques qu’il implique, cassent la créativité économique et créent le chômage, au nom de la justice et de la protection sociales. Que ce soit en politique ou en économie et en finance, la démocratie n’est pas facile à définir et encore moins à pratiquer. Du moins exige-t-elle une certaine transparence des pratiques et de l’information, une égalité des droits et une représentativité des citoyens, un équilibre des pouvoirs, une discipline et des sanctions, un rythme de renouvellement des dirigeants en place : autant de principes qui finissent par converger vers un mode de fonctionnement plus prudent et plus équitable. Seuls ces principes nous permettront de sortir du féodalisme actuel, de sa liberté dévoyée, et de construire peu à peu des règles, des usages et des mœurs économiques et financières démocratiques. Or il est clair qu’au nom du néolibéralisme, nous avons évolué depuis quelques décennies, exactement dans la direction opposée. Nous avons fait confiance à la loi de la jungle économique. En cette année où nous célébrons le bicentenaire de la naissance de Darwin, nous constatons que beaucoup d’Américains, notamment ceux qui votent républicain, sont paradoxalement créationnistes en religion et darwinistes en économie. Or aujourd’hui, l’heure n’est plus au darwinisme économique. La nature ne connaît pas la morale. La solution n’est pas dans l’adaptation, mais dans la divergence, qui consistera à instituer la même éthique démocratique en économie et dans les finances, que nous exigeons en politique. Cela ne se fera pas en un jour, mais nous devons le faire.
Hervé Fischer
Nous sommes attachés à la démocratie politique et l’avons consolidée peu à peu dans plusieurs pays. La démocratie est un mythe actif de fondation de nos sociétés occidentales actuelles. Il est laïc et égalitariste. Il prévaut en politique, mais le monde financier l'ignore ou le rejette encore pour faire prévaloir ses privilèges archaïques. La justice appartient à cette même constellation mythique de la démocratie. Elle est réaffirmée constamment et encore plus souvent bafouée. Nous rencontrons là, cependant les deux mythes sur lesquels repenser et réorienter le capitalisme.
Mais dans ces mêmes pays, dits modernes, nous en sommes encore au stade du féodalisme dans l’économie et les finances. Les terribles effets pervers de ce décalage historique nous apparaissent clairement dans la crise actuelle. L’histoire nous rappelle que les seigneuries du Moyen-Âge, puis les aristocraties qui en sont nées, ont su maintenir leur emprise politique pendant des siècles. Il a fallu des révolutions pour leur arracher leur pouvoir et construire, par à coups, les démocraties politiques actuelles, encore très imparfaites. Il est certain qu’il ne faut pas attendre davantage des princes de la finance et de l’économie qu’ils renoncent aujourd’hui spontanément à leurs privilèges et se réforment d’eux-mêmes. Cela prendra encore de nombreuses turbulences, telles celles de 1929 et de 2008. Et ce sont les institutions politiques élues par les masses qui seules pourront venir à bout de cet anachronisme et de ses conséquences dramatiques. Les petits épargnants d’aujourd’hui sont manifestement les serfs et la chair à canon des rois de la spéculation qui règnent sur notre économie financière, comme jadis les paysans se faisaient systématiquement exploiter par les seigneurs. Le nouveau président américain a posé des gestes symboliques à cet égard en plafonnant les salaires des grands argentiers et chefs des entreprises que l’État a sauvés de la faillite avec l’argent des contribuables.
Le mur de Berlin du capitalisme
L’économie néolibérale a montré les mêmes abus de pouvoir qui sévissaient sous le régime féodal du Moyen-Âge: les privilèges exorbitants, l’exploitation des faibles, le secret, le fait du prince, le cynisme, l’arrogance, le racket, la prédation, la violence ordinaire. Ces outrances ont été telles qu’elles ont délégitimisé le capitalisme libéral, comme les excès du socialisme soviétique en ont ruiné les possibles vertus. On pourra établir un parallèle avec 1989 et se demander si ce capitalisme sans retenue, libéré de l’hypothèque du communisme, n’a pas rencontré à son tour, vingt ans plus tard, son mur de Berlin – disons son mur de Wall Street.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les actifs bancaires perdus depuis un an sont évaluées à 2200 milliards de dollars; le président de News Corp a estimé, à l’occasion du Forum de Davos, que 50 000 milliards d’actifs de patrimoines individuels seraient partis en fumée. Aux États Unis, le gouvernement aura, selon les chiffres qui circulent, versé quelques 8000 milliards en moins d’un an pour secourir les grandes banques, les assurances et les entreprises notamment dans le secteur de l’automobile. Et cela n’aurait pas empêché les financiers américains responsables de cette catastrophe d’empocher des bonus de 150 milliards depuis cinq ans. Mieux : en pleine crise, ils ont continué à s’accorder mutuellement des bonus exorbitants directement pris dans les fonds de secours offerts par l’État américain. On a même pu observer la difficulté du président Obama à trouver des collaborateurs de haut calibre ayant acquitté tous leurs impôts. Selon les dernières prévisions du Bureau International du Travail, la crise mettra plus de 50 millions de personnes au chômage dans le monde, pour un total de 80 millions de chômeurs, qui pourrait monter jusqu’à 200 millions si la crise dure – une évaluation officielle qu’il faut multiplier au moins par deux pour avoir un estimation réaliste des sans emplois et par cinq pour chiffrer le nombre des êtres humains vivant dans une extrême pauvreté. La dérégulation, un endettement généralisé et une consommation effrénée, l’économie imaginaire et les folies financières des États-Unis nous ont conduit au seuil de la déraison et de turbulences sociales et politiques qui pourraient aggraver encore la situation mondiale.
Bien sûr, la solution ne consiste pas à diaboliser le capitalisme, qui prône la liberté d’entreprendre nécessaire à la création de richesses, et qui demeure assurément la moins pire des idéologies. Mais encore faut-il revenir à son esprit fondateur ou, l’adapter à l’éthique actuelle des classes moyennes. Alan Greenspann, lorsqu’il était président de la Réserve fédérale américaine, avait souligné les risques d’une « exubérance irrationnelle » de l’économie. Et tandis que le Président Obama dénonce la cupidité "honteuse" de plusieurs financiers et entrepreneurs nord-américains, il est bon de rappeler ces mots de Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme: "L'avidité du gain sans limite n'a rien à voir avec le capitalisme, et encore moins avec son esprit. Le capitalisme s'identifierait plutôt à la domination, à tout le moins à la modération rationalisée de cette pulsion irrationnelle". Et il souligne que ce capitalisme repose sur une attitude pacifiste favorisant les échanges, plutôt que sur la conquête, l'exploitation, le cynisme et la violence. Il souligne que c'est son éthique qui a d'abord fondé son succès. Autrement dit, si nous voulons en finir avec les prédateurs et les escrocs du capitalisme déréglé, les justiciers et les Robin des bois ne suffiront pas à la tâche, qui est colossale. Il faut remettre à l’ordre du jour et instituer un certain rationalisme économique, avec les mêmes exigences qui prévaut dans les règles de la démocratie politique. La démocratie ne peut pas être seulement politique. Elle doit aussi être économique et financière. Si non elle n’existe pas réellement.
Certes, nous savons qu’une volonté excessive de rationalisme économique conduit à des effets pervers. Le socialisme économique qui ne dit pas son nom, comme en France, et les excès bureaucratiques qu’il implique, cassent la créativité économique et créent le chômage, au nom de la justice et de la protection sociales. Que ce soit en politique ou en économie et en finance, la démocratie n’est pas facile à définir et encore moins à pratiquer. Du moins exige-t-elle une certaine transparence des pratiques et de l’information, une égalité des droits et une représentativité des citoyens, un équilibre des pouvoirs, une discipline et des sanctions, un rythme de renouvellement des dirigeants en place : autant de principes qui finissent par converger vers un mode de fonctionnement plus prudent et plus équitable. Seuls ces principes nous permettront de sortir du féodalisme actuel, de sa liberté dévoyée, et de construire peu à peu des règles, des usages et des mœurs économiques et financières démocratiques. Or il est clair qu’au nom du néolibéralisme, nous avons évolué depuis quelques décennies, exactement dans la direction opposée. Nous avons fait confiance à la loi de la jungle économique. En cette année où nous célébrons le bicentenaire de la naissance de Darwin, nous constatons que beaucoup d’Américains, notamment ceux qui votent républicain, sont paradoxalement créationnistes en religion et darwinistes en économie. Or aujourd’hui, l’heure n’est plus au darwinisme économique. La nature ne connaît pas la morale. La solution n’est pas dans l’adaptation, mais dans la divergence, qui consistera à instituer la même éthique démocratique en économie et dans les finances, que nous exigeons en politique. Cela ne se fera pas en un jour, mais nous devons le faire.
Hervé Fischer
S'abonner à :
Messages (Atom)