tout ce qui est réel est fabulatoire, tout ce qui est fabulatoire est réel, mais il faut savoir choisir ses fabulations et éviter les hallucinations.
jeudi, décembre 30, 2010
Mythanalyse du corps humain
Les Grecs anciens ont été les premiers à célébrer dans leurs temples la beauté plastique du corps humain et son anatomie musculaire précise et réaliste, plutôt que de multiplier les sculptures animistes de serpents, dragons, singes, chats, oiseaux ou végétaux des autres civilisations. Pour en glorifier l’image, ils ont recouru à la noblesse lumineuse du marbre blanc. Puis nous observons, selon les époques, les sociétés et les cultures, des tendances tantôt très réalistes, tantôt abstraites, religieuses et symboliques. Dans l’islam et le protestantisme, c’est même l’interdiction de toute représentation visuelle de dieu et de création, y compris l’homme qui s’est imposée.
La représentation de l’humain, spirituelle ou corporelle, est iconique de chaque culture ; elle synthétise les rapports que l’homme construit entre lui et l’univers, donc sa propre image dans celle du monde, selon la cosmogonie et les interprétations idéologiques qu’il adopte. Qu’en est-il alors de l’homme de la modernité occidentale. Il était nécessaire de faire ce rappel historique pour mieux comprendre la signification des mutations actuelles.
La sculpture et la peinture européennes ont transformé nos représentations classiques de l’humain, principalement du point de vue perceptif de la réalité visible : convention réaliste, impressionnisme, naturalisme, fauvisme, cubisme, surréalisme, hyperréalisme, etc. Le sentimentalisme romantique, puis le symbolisme (qui a eu un fort impact dans la sculpture qui a suivi), ont maintenu une tradition plus spirituelle. Le futurisme et le réalisme socialiste, mais aussi un Fernand Léger, ont tous célébré, quoique de façon très différente, la nouvelle puissance de la technologie et de l’homme prométhéen, constructeur d’un monde nouveau.
Les artistes qui ont rapporté des dessins des camps de concentration, et les postmodernes deepuis, comme Christian Boltanski, Arnulf Rainer, mais aussi des sculpteurs comme Giacometti, Eva Hesse, Louise Bourgeois, Betty Goodwin, ont exprimé le malaise, la souffrance, la fragilité, l’éphémérité, la destruction de l’homme, cédant souvent à une grande morbidité. Mais ce sont les artistes de la performance et de l’art corporel des années 1960 et 1970, des artistes comme Hermann Nitsch, Gina Pane, Michel Journiac, Vito Acconci, Chris Burden, qui ont exprimé de la façon la plus extrême la douleur, le désenchantement, le catastrophisme, voire le nihilisme de notre époque. Ces représentations doloristes, masochistes évoquent nettement la tradition chrétienne biblique de flagellation, de la punition du corps. Certes, l’intention n’en était nullement exprimée clairement par ces artistes, mais les références nombreuses et explicites que faisaient Michel Journiac et les actionnistes viennois à la religion en témoignent clairement.
Il est d’autant plus étrange qu’en 40 ans nous soyons passés d’un extrême à l’autre : nous optons aujourd’hui pour une attitude extrêmement optimiste, mais selon deux directions étonnamment contradictoires, du moins en apparence.
D’un côté nous valorisons le corps naturel, nous l’icônisons dans la publicité, qui promeut et vend les produits d’une industrie florissante de la beauté du corps – naturisme, nudité, gymnastique, body building, maquillage qui rehausse le naturel, chirurgie plastique qui permet de lutter contre le vieillissement, santé par les produits naturels, etc.
D’autre part, des gourous nous proposent une nouvelle représentation du corps grâce aux technologies numériques. Cette utopie technoscientifique posthumaniste correspond à un nouvel espoir cosmogonique et nous annonce une superpuissance humaine arrimée aux technologies informatiques. Des représentants majeurs des arts scientifiques, tels Stelarc, Eduardo Kac, le mouvement australien Symbiotica usent de prothèses, manipulent l’ADN, rêvent de nanotechnologies, conçoivent l’espoir d’un être humain chimérique, qui cèderait son pouvoir cérébral à l’informatique pour une nouvelle ère de notre évolution humaine, jusqu’à un dépassement radical de l’humain par le silicium intelligent.
Quelle que soit l’opposition de ces démarches, l’une naturaliste, l’autre numérique, c’est dans les deux cas par l’artifice que nous tendons à doter notre corps de beauté et de force supérieures. Dans les deux cas, il s’agit d’un rejet de l’idéologie biblique et d’un retour à la pensée et à la sensibilité grecques, celles de la beauté du corps humain à célébrer, et à renforcer selon notre instinct prométhéen, celui de l’homme créateur de lui-même. Un rêve de puissance. Nous voulons devenir à notre tour des dieux, beaux comme des dieux, puissants comme des dieux*.
Hervé Fischer
-----------------------------
*"Nous serons des dieux", éditions vlb, Montréal, 2007
mardi, décembre 28, 2010
Mythanalyse du numérique
Il n’y manque plus que Dieu. Le numérisme n’a pas manqué de créer une sorte de religion, avec ses communautés virtuelles, telles les églises Apple, Microsoft, Google, Facebook, ou les paroisses Myspace, Youtube, Twitters, Skype, leurs fidèles et leurs infidèles, des codex pour les initiés, une discrimination entre ceux qui sont connectés, sans cesse connectés à ce monde supérieur - les intelligents -, et ceux qui ne le sont pas - les païens, les obscurantistes. Et le posthumanisme nous annonce une sorte de paradis intelligent à venir sous le règne du numérique.
Il est étonnant de constater que le réalisme, né avec la Renaissance, pourtant si instrumental de notre puissance occidentale, n’aura guère duré plus de cinq siècles, un instant en comparaison des milliers d’années d’évolution de notre espèce. Nous n’aimons pas les païens, ni les athées, ni les démystificateurs. Nous voulons des dieux, des intelligences supérieures – aujourd’hui celle du Grand Ordinateur* -, nous avons besoin d’excommunications, de dépendance, de soumission. Nous nous berçons encore d’illusions et de chimères, un doux mélange d’idéalisme platonicien, de magie numérique, avec ses rites, ses initiations, ses célébrations, ses marchands du temple, ses prêtres, ses gourous, ses chamans et les formules de sorcellerie de ses algorithmes. Et dire que nous nous croyons modernes ! Et même postmodernes ! Posthistoriques !
Paradoxalement, seuls les philosophes nous invitent quasiment tous à nous détourner de ce nouvel idéalisme. Ils n’en ont pas encore perçu le pouvoir intellectuel et spirituel. Ils se gargarisent encore de Platon, de ses leurres et de ses fantasmes, sans avoir compris que nous y sommes revenus, étonnamment par le biais de la technologie, comme avait su le comprendre McLuhan. Au nom d’un humanisme vieillot, au nom de la philosophie, ils veulent nier l’importance radicale de la révolution informatique et son impact sur notre civilisation et précisément sur nos idées. Ils se sont trompés d’adversaire. Ils devraient plonger dans le numérisme avec ferveur.
Nous voilà donc confrontés à de grands malentendus, comme il est arrivé si souvent dans l’histoire des idées. Les philosophes ont raison de se méfier du numérisme, mais ils ne le critiquent pas pour les bonnes raisons ; d’ailleurs ils le méconnaissent presque tous. Nous avons un besoin urgent de cyberphilosophie face à la révolution numérique, pour la comprendre, la démystifier, mais aussi en reconnaître les valeurs, la puissance créatrice, mais aussi l’immensité des responsabilités qu’elle nous impose et la solidarité qu’elle éveille. Au-delà de l‘utopie technoscientifique et de ses excès, c’est notre liberté et notre lucidité qu’elle exige à un niveau inédit dans notre histoire humaine.
Lorsqu’on prend conscience de l’influence immense de l’idéalisme platonicien sur l’évolution de l’Occident, alors que ce n’était qu’un phantasme philosophique, à quoi ne devons nous pas nous attendre avec le numérisme, qui est, quant à lui, technoscientifique et donc porteur d’un pouvoir instrumental exorbitant !
Ce sera sans doute, la puissance technologique même de cette révolution numérique, qui nous imposera, par un de ces paradoxes dont l’histoire a le secret, le « supplément d’âme » dont nous avons le plus urgent besoin pour assurer la survie de notre espèce, beaucoup plus encore que des progrès de la science et de la technologie : un profond consensus humain pour nous soumettre aux exigences d’une éthique planétaire.
Hervé Fischer
---------------------------------------------
* C'est Jacques Perret, professeur de philologie latine à la Sorbonne, qui a proposé en 1955 de traduire le mot américain "computer" par "ordinateur", un mot emprunté au vocabulaire théologique. « C’est un mot correctement formé, écrit-il, qui se trouve même dans le Littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l’ordre dans le monde. »
vendredi, décembre 17, 2010
Babel mon amour - mythanalyse des masses
Un monde paradoxal émerge entre les deux pôles de la mondialisation et de la diversité. La Terre est devenue une galaxie de planètes. Nos sociétés ont beaucoup changé ; et nous aussi. Nos vies se jouent entre le culte de l’individu et le pouvoir des masses, entre le sentiment irréductible de l’existence intime et la conscience de l’autre que nous sommes aussi. On me pense, protestait déjà Arthur Rimbaud. Sur le rivage de soi-même, chacun explore ce monde bigarré de l’humain, tout à la fois proche et lointain, éclaté et englobant, à l’image de peintures impressionnistes constituées de petites touches de couleur autonomes juxtaposées, dont les énergies s’unifient à distance.
Les masses sont-elles les nouveaux dieux d’un univers de particules en incessante agitation ? Nos cosmogonies pulsent avec les flux et les reflux des forces de fragmentation et d’unification. Confrontés à des vitesses inédites et aux accélérations du changement, nous construisons, déconstruisons, transformons des liens, des divergences et des projets selon nos instincts de plaisir, de mort et de puissance, mais aussi selon notre désir supérieur d’humanité. Nos solitudes se conjuguent avec nos solidarités. Notre conscience planétaire se fonde sur des abîmes sociaux.
Des masses individualistes
Pour élucider ces paradoxes, il faut évoquer l’histoire. Depuis la rupture mythique de 1789, l’Occident est passé de l’ordre aristocratique à celui de la bourgeoisie, bientôt dominée par les aspirations des classes moyennes. Après la montée des fascismes, les désastres des guerres et des génocides, nous avons connu l’imaginaire libérateur de Mai 68, dont on se demande encore s’il a brillé comme un feu de paille ou fondé des espérances durables.
Nous pensons vivre aujourd’hui dans des sociétés de masse individualistes. Mais existent-elles vraiment ? N’observons-nous pas le recul des collectivismes? Les masses sont-elles des mégaféodalités économiques ou le volant d’inertie de nos inclusions sociales ? Des agrégats déstructurés qui flottent au gré de courants chaotiques, ou le ballet aussi précis qu’imprévisible des bancs de poissons et des volées de perroquets ? Le ventre mou du social ou des représentations créées par la société de l’information dans lesquelles nous projetons nos peurs et nos espoirs ? Réelles ou imaginaires, elles n’en sont pas moins déterminantes. Nées du choc démographique, elles se conjuguent avec la nouvelle puissance des technologies numériques, dont le pouvoir intégrateur et l’apparente apesanteur sociologique ne sauraient nous dissimuler l’atomisation de nos consciences et les fractures sociales.
Existe-t-il une idéologie des masses ?
Les impérialismes et les colonialismes ont fait leurs temps. Destructeurs, ils sont devenus illégitimes. La manipulation des masses et le colonialisme des individus en auraient-ils pris la relève ? Au-delà de ce qu’on pourrait penser comme une fatalité quantitative, sommes-nous dominés par une idéologie des masses ? Quelles seraient ses structures, ses valeurs, ses symboles ? Serait-elle posthistorique ou prétendrait-elle encore invoquer le progrès? De quels mythes fondateurs tiendrait-elle alors sa légitimité ? Du triomphe final du monothéisme universaliste sur les diversités polythéistes, de Dieu sur Prométhée ? Le monde s’occidentalise-t-il ? L’Occident se banalise-il ? Nous pensons les synchronicités comme des écosystèmes.
Les yeux tournés vers les vitraux cathodiques de nos sociétés écraniques, nous situons imaginairement les serveurs informatiques dans les nuages du cloud computing, comme un nouveau dieu du ciel et nous en remettons à l’intelligence artificielle comme jadis à la providence. Comment concilier le vieil idéalisme de l’unité avec le nouveau mythe de la diversité sur terre ? Et celui-ci avec l’égalitarisme démocratique, incompatible avec la loi du plus fort qu’implique la biodiversité de la nature ? Mieux vaut réécrire le mythe de la Tour de Babel comme le drame des hommes aux prises avec eux seuls. Mais peut-on composer une sonate à deux, à trois, à mille pianos ?
La nature elle-même a beaucoup changé en deux siècles. De romantique et intimiste, elle est devenue aujourd’hui politique et scientifique. Célébrée en raison tout à la fois de sa puissance et de sa fragilité, elle cède pourtant aux espoirs de l’artifice.
Le narcissisme n’a plus guère cours. Le sujet semble se banaliser dans un monde d’objets qui s’annoncent intelligents et connectés. Le corps est-il désormais obsolète, comme l’affirment les posthumanistes, alors que nous en célébrons tant les icônes ? L’homme devient-il le grand absent de ce monde technoscientifique, ou est-il le seul centre pensable d’un univers infini? Le culte des idoles médiatiques érigées en demi-dieux vise-t-il à compenser les frustrations de nos anonymats individuels?
Nos structures mentales sont déstabilisées. Nous délaissons le mythe de la profondeur de la pensée et de l’inconscient individuels pour celui de la surface et de la navigation numérique. Nous avons abandonné la causalité linéaire pour l’arabesque heuristique des liens. Nous explorons les lois du chaos, les logiques floues, et admettons le principe d’incertitude. Nous avons renoncé aux utopies politiques du XIXe siècle pour proclamer celle de la technoscience, devenue le moteur de notre évolution. Nous célébrons l’interactivité et le web 2.0, qui semblent symboliser la créativité humaine dans l’uniformisation des masses.
Nous vivons de plus en plus dangereusement
Le mythe de la diversité et la multiplication des rationalités qu’il consacre nous annoncent-t-ils le retour des barbares et de l’obscurantisme ? Ou serons-nous capables de nous les approprier ? Les libertés individuelles seront-elles laminées par les logiques des mégastructures et les menaces des terrorismes ? La puissance des masses sera-t-elle battue en brèche par les nationalismes identitaires, les multiculturalismes et les nouveaux tribalismes ? Les égalitarismes résisteront-ils au néo-libéralisme darwinien? La montée des intégrismes et la multiplication des sectes auront-elles raison de la généralisation de l’athéisme ? L’émotivité des flux de cultures de plus en plus liquides bannira-t-elle l’arrêt sur image et le temps de la pensée critique?
Le futur se dilue dans les arabesques de l’événementiel. La mémoire du passé est orpheline. La déréliction semble se répandre comme une tâche d’huile. Confrontés à notre nouvelle puissance instrumentale, nous vivons de plus en plus dangereusement. Le désenchantement postmoderne cèdera-il face au retour du désir de progrès ? Le nihilisme face aux promesses du numérique ? Ou le cynisme, la violence et l’exploitation humaine l’emporteront-ils sur les exigences d’une éthique planétaire ?
Le choc soudain et extensif de la diversité, et son culte en contradiction avec la dynamique uniformisatrice des masses, ont provoqué une réactivation du mythe de l’unité, la montée des intégrismes, et cette étrange dépendance aux médias sociaux que nous observons. Nous sommes de moins en moins modernes. Quels mythes saurons-nous identifier, réactiver, transformer ou inventer pour reprendre le contrôle de notre destinée ? Entre l’ombre et la lumière de l’humanité, l’avenir est en suspens.
Hervé Fischer
dimanche, février 28, 2010
Les théories sont des fictions
Le romancier évoque sans insistance, il dit moins pour suggérer plus, il use de l’ambiguïté, du non dit, se contredit, cultive le flou, étale sa mauvaise foi, ment comme un arracheur de dents, pour donner à son récit l’épaisseur, l’obscurité, la puissance de la vie. Il mystifie pour être vrai. Tout à l’opposé, l’essayiste tente de tout dire, de mettre à nu, d’expliciter ce que cache l’obscurité d’un cliché, il met en lumière l’incertitude de l’évidence, il articule les raisons implicites, il cherche la cohérence, il démystifie, pour mettre la vérité à plat et convaincre son lecteur de la pertinence aigue de ses affirmations. Voilà donc deux écritures opposées, la romanesque et la théorique, qui adoptent deux stratégies inconciliables. Ce qui fait généralement du romancier un mauvais théoricien, et de l’essayiste un mauvais romancier. Il y a pourtant de grandes exceptions. Certainement pas Sartre, même si sa célébrité lui a valu une attribution de Prix Nobel, mais Camus, Umberto Eco. Peut-être le degré zéro de l’écriture de L’étranger s’y prêtait. Peut-être les intérêts intellectuels d’Eco pour la langue et la sémiologie aussi. Mais poussons le questionnement un peu plus loin. Lorsque j’affirme que les théories sont des fictions – ou des romans -, je souligne évidemment plusieurs aspects importants de l’écriture théorique. Essayons de les décliner ici :
-Toute théorie est un récit, qui met en scène des acteurs, des objets, un contexte, des buts, une conjugaison des verbes qui introduit le temps de l’action. Ce récit a une structure familiale, qui met en jeu le père, la mère, le fils, la fille, et rend ainsi l’explication familière, c’est-à-dire semblable à une structure que nous admettons parce qu’elle nous est co-existentielle.
- Tout concept, même le plus abstrait, est un concept-image, dont le sens trouve ses racines dans l’évocation qu’il recèle. Ainsi, «s’orienter», c’est se tourner vers la lumière qui se lève et fend l’obscurité. Le sens est une direction ; comprendre, c’est lier, etc. Cette cause là est entendue, c’est-à-dire vraie parce que souvent redite.
-Toute pensée, même la plus théorique, est métaphorique. Nous pensons par images que nous agrégeons selon des liens familiers : cela rejoint nos structures mentales biologiques, celles que nous avons développées dans nos rapports familiaux avec le père et la mère, ceux qui savaient. Je l’ai écrit dans Mythanalyse du futur, il y a déjà dix ans (*), toute théorie est un roman des origines, que chaque penseur réécrit dans son style et selon ses motivations contextuelles.
- Toute élaboration théorique est une tentative de prise de pouvoir : sur l’autre, sur nos angoisses, sur nous-mêmes. Elle nous libère ou nous donne un avantage social. Elle comporte donc un investissement psychique personnel. Cette motivation intime est-elle étrangère aux exigences d’objectivité ou de neutralité de la connaissance ? On l’a dit à satiété. Mais en fait, elle est dans la nature même de notre désir de connaissance, dans notre exigence de dévoilement (encore une image qui ne laisse pas de doute sur notre désir). Les batailles d’arguments auxquels se livrent les théoriciens, qu’ils soient physiciens, historiens, économistes, écrivains ou peintres avant-gardistes, nous confirment la présence de ces enjeux constants de pouvoir. Il faut avoir raison de l’autre !
Aucune théorie n’échappe à ces déterminants que la mythanalyse essaie de mettre en lumière. La mythanalyse n’y fait, bien sûr, pas exception. Elle est une démarche obsessive de lumière et de libération. Elle veut enfanter, mettre au jour, c’est-à-dire à la lumière et nous apporter la délivrance, au sens même de l’accouchement, qui est aussi l’é-ducation sociale (la voie de sortie) de l’in-fans (celui qui n’a pas encore la parole et donc n’est pas encore un adulte). On n’en finirait pas de rappeler toutes les étymologies significatives de notre cheminement sur la voie de la connaissance. Quel récit ! Que de promiscuité ! La scène familiale de la naissance demeure le mythe élémentaire, biologique, sur lequel se fonde la mythanalyse. Ce que la mythanalyse recherche, c’est l’analyse du récit de notre origine, capable de révéler le sens de nos métaphores et finalement de nos imaginaires, à la fois individuels et collectifs – individuels parce que collectifs. Dire que toute théorie est une fiction, un roman, c’est seulement rappeler ce que nous tenons tellement à oublier, qui est l’origine familiale et biologique de nos efforts théoriques, ceux que nous déclarons les plus objectifs.
Hervé Fischer
(*) Mythanalyse du futur, www.hervefischer.net (2000).
lundi, septembre 07, 2009
La boîte de Pandore numérique

Voilà 40 ans, depuis le 2 septembre 1969 qu’est né l’internet. En fait, ce ne fut encore que la communication, fort laborieuse et limitée, entre deux ordinateurs reliés par un câble de 4,50 m de longueur, à l’université Californie à Los Angeles. Puis on a élargi les distances avec les universités de Stanford, Santa Barbara et l’Utah. On peut discuter la date, souligner le rôle de Licklieder, du MIT, qui eut la vison de l’importance de ces futurs réseaux de communication. On doit citer Leonard Kleinrock, qui théorisa dès 1961 la commutation et la transmission d’informations par « paquets », Paul Baran et Douglas Engelbart, dont nous allons reparler. Les auteurs sont plusieurs. Ce fut une histoire militaire autant qu’universitaire, comme le rappelle la signification d’Arpanet, créé par la Defense Advanced Research Projects Agency pour assurer la sécurité de ses communications en temps de guerre grâce à un réseau (Network) décentré multipolaire, qui deviendra notamment le MILnet (Military Network).
Voilà 40 ans aussi, que Douglas Engelbart a inventé au Stanford Reearch Institute la fameuse souris dont nous nous servons encore aujourd’hui pour déplacer le curseur sur nos écrans d’ordinateur. Il n’en reçut aucun dividende financier, mais le SRI vendit le brevet à Apple qui a donné à ce petit rongeur à queue numérique l’expansion que l’on sait. On attribue aussi généralement à Engelbart le concept d’intelligence collective, dont il a exposé la philosophie dans Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework.
Aujourd’hui, seulement deux générations plus tard, alors que nous comptons plus de 1,3 milliards de personnes connectées sur la planète à l’internet grâce au Web et au sans fil, il est bon de rappeler que c’est avec un câble de 4,50 m que cela a commencé. De petites inventions peuvent avoir un impact extensif sur toutes nos activités en quelques décades. C’est cela qui caractérise l’évolution de notre espèce et l’accélération que nous expérimentons à l’époque actuelle. L’âge du numérique commence à peine, mais il nous oblige déjà à changer drastiquement nos comportements et réinterroge nos valeurs. Saurons-nous maîtriser le choc du numérique? La boîte grecque de Pandore que nous avons ouverte, ou la pomme, son équivalent biblique, sont aujourd’hui numériques, nous donnant accès à plus de pouvoir, plus de connaissance, plus de conscience planétaire, plus de bien – le progrès non seulement technique mais aussi humain – et plus de mal aussi. Faut-il diaboliser une fois encore cette pomme numérique et accuser le Satanford Research Institute, ou assumer les responsabilités éthiques qui viennent avec Prométhée et avec la conscience? Est-il pertinent de parler d’une « augmentation de la conscience collective » ou d’une « intelligence collective augmentée »? Souhaitons que l’utopie se réalise. C’est manifestement l’utopie la plus en vogue aujourd’hui parmi les philosophes du numérique les plus optimistes. Mais cela demeure encore à démontrer, tandis que les raisons d’en douter augmentent elles aussi. Le défi nous confronte à nous-mêmes. Il n’est plus religieux, il n'est pas technique. Il est éthique. Et planétaire.
samedi, mai 16, 2009
Evolution et création

En cette année Darwin où nous célébrons le 200e anniversaire de sa naissance et le 150e de «De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle», nous nous devons de reconnaître que la théorie darwinienne de l’évolution naturelle constituait une formidable rupture par rapport à la croyance en Dieu qui dominait alors l’Occident.
Cet hommage admiratif étant rendu, force est de constater que sa théorie demeure fondamentale pour comprendre l’évolution du règne animal, mais ne permet pas d’expliquer le développement de l’espèce humaine. En comparaison des autres mammifères, nous avons connu une évolution si rapide qu’on ne peut plus parler d’adaptation et de sélection naturelle, mais qu’il faut considérer des mutations dramatiques et répétées. À plusieurs reprises déjà j’ai souligné qu’il est nécessaire d’envisager une Loi de la divergence, qui est le contraire de la Loi de l’adaptation (1). Le génie de Darwin lui-même en constitue un exemple indéniable, en un temps où Dieu et la création divine – le créationnisme – s’imposait à tous. La transformation rapide et majeure de l’espèce humaine, par rapport aux autres espèces vivantes, s’est faite par mutations biologiques qui ont moins répondu à des contraintes extérieures, écologiques, qu’à des projets spontanés du cerveau humain. Si nous nous référons à l’histoire récente, nous constatons que l’invention de la roue, ou la maîtrise du feu, de l’électricité ou du nucléaire ont résulté d’un développement des capacités cérébrales conceptuelles de notre espèce. Sans doute ce pouvoir n’est-il pas unique. Plusieurs espèces animales conçoivent aussi des outils. Le castor construit des barrages, les fourmis et les abeilles créent des sociétés industrieuses ; et nous pourrions citer mille exemples qui contredisent la différence radicale de nature entre l’homme et l’animal affirmée à tort par tant de philosophes et d’anthropologues, célèbres, mais ethnocentristes. De fait, l’homme procède systématiquement par divergence. Son histoire le démontre. L’invention grecque du rationalisme, les monothéismes, les théories scientifiques, les révolutions sociales, l’histoire de la peinture, celle des technologies et l’invention du verre, du béton ou du plastique. On pourrait y consacrer des milliers de pages admiratives. Ce n’est jamais par adaptation que l’histoire humaine procède, mais par volonté de rupture, au risque que leurs auteurs soient d’abord marginalisés, honnis, martyrisés, tués, ou se condamnent eux-mêmes à la folie, tant l’écart qu’ils doivent assumer solitairement est démesuré. La plupart des grandes idées qui ont fait notre histoire ont été d’abord condamnées avant d’être admises, puis de s’imposer aux majorités qui s’y sont adaptées.
Bien que nous soyons des animaux, incluant des animaux philosophes ou des mathématiciens animaux, nous sommes capables de diverger des lois connues de la nature, comme si nous en étions une tête chercheuse, une intelligence avancée, un organe créatif capable d’en accélérer la transformation en inventant des scénarios alternatifs. Notre espèce est fascinée par l’artifice, au point où elle semble se séparer audacieusement de la nature. La loi de la divergence est le fondement même de la création – que ce soit celle que la Bible attribue à un dieu, ou le pouvoir de création que nous devons nous reconnaître à nous-mêmes (2).
L’espèce humaine évolue au rythme des divergences créatrices de ses imaginations, de ses idées, de ses projets, de ses nouvelles logiques, de ses innovations technologiques, de ses projections dans des utopies. Sans cela, nous n’aurions pas inventé les avions. Et chaque fois qu’il y a un saut, l’être humain, voire le groupe, voire l’espèce humaine elle-même mettent en jeu leur survie. Ainsi, l’énergie nucléaire, ou la seule transformation industrielle de notre environnement mettent en péril la survie de notre planète. Faut-il demeurer darwinien et croire, comme on l’a dit parfois, que la nature vise ainsi à éliminer l’espèce humaine pour assurer sa propre survie ? On ne saurait en tout cas affirmer alors que la loi darwinienne s’applique à l’espèce humaine. Et c’est bien ce que je veux souligner. Car en devenant créatrice, notre espèce prend le risque radical de sa propre extinction.
Dès le moment où l’homme descend des arbres et adopte une posture verticale pour se déplacer, à la différence des autres primates, puis spécialise son évolution en développant des capacités cérébrales qu’on n’observe pas chez les autres animaux, il est clair que cette divergence se traduit par des mutations mentales, psychologiques, sociales qui s’inscrivent biologiquement dans le corps (colonne vertébrale, cerveau, habileté manuelle, etc.). Irions-nous jusqu’à parler alors de transformations génétiques ? Oui : l’évolution de notre corps actuel le confirme. Mais à la différence de Darwin, nous ne l’attribuons pas à une sélection naturelle opportuniste, qui élimine les désadaptés et assure la survie de ceux qui ont des écarts génétiques accidentels devenus utiles. Il s’agit de mutations génétiques résultant de projets humains, d’imaginations alternatives, de conceptualisations de l’avenir, bref d’une conscience et d’une volonté proactive d’évolution. La loi de la divergence diverge donc radicalement de la loi darwinienne. Irions-nous donc jusqu’à penser que les idées peuvent provoquer des mutations génétiques ? On hésite certes à faire le saut avec une telle affirmation, qui fait peur, car elle véhicule aussi la possibilité de ses effets pervers : toutes les idées ne sont pas bonnes. Allons-nous admettre que le déisme, les superstitions, le racisme, le fascisme, l’injustice, l’exploitation, le sadisme, le crime peuvent créer des mutations génétiques ? Et inversement faudrait-il admettre que l’inclination au crime serait due à un gène ? L’idée va manifestement plus loin que nous ne sommes prêts à l’accepter. Cependant il est simpliste de parler seulement de génétique, les gènes ne constituant certainement qu’un niveau élémentaire («squelettique») de description des déterminants de notre évolution et de nos comportements. Ainsi, lorsque nous admettons la légitimité des orientations sexuelles, il n’est pas nécessaire d’invoquer une différence génétique, là où des diversités hormonales où socio-culturelles suffisent sans doute à expliquer des différences de comportements. Par prudence par rapport au vocabulaire scientifique contemporain, et pour éviter de fausses polémiques, nous nous limiterons à affirmer que les idées et l’imaginaire humains (ce sont deux déclinaisons de la même activité cérébrale, soit plus conceptuelle, soit plus imagée) créent des mutations biologiques de l’espèce, qui déterminent, voire accélèrent son évolution.
J’en donnerai aussitôt un exemple très significatif. Quoiqu’en ait dit Jean-Jacques Rousseau en un temps d’utopie libératrice, il est évident que l’éthique n’existe pas dans l’état de nature. C’est la loi de la jungle ou loi du plus fort qui y règne. Qu’importe la violence ou la modération dont la nature fait preuve, les valeurs du bien et du mal ne s’y rencontrent pas. L’éthique est une invention humaine, spécifique à notre espèce, et sans doute récente dans notre évolution. Or l’éthique, telle que nous la concevons, et telle que nous l’appliquons – encore trop peu et trop rarement – constitue une divergence radicale par rapport à la loi darwinienne de l’évolution naturelle. Elle implique que nous ayons de la compassion pour les faibles, les malades, les infirmes et tentions de les protéger, voire de les sauver, au risque même qu’ils se reproduisent et transmettent leurs gènes qui constitueront éventuellement un maillon faible dans notre chaîne évolutive. La loi de l’adaptation naturelle voudrait au contraire que nous les éliminions, comme s’y est employé le nazisme dans sa politique eugéniste. D’ailleurs, les fascismes ne se contentent pas de mettre en prison, mais s’assurent d’éliminer les individus porteurs d’idées différentes, comme s’ils avaient des gènes dangereux pour l’avenir. L’invention de l’éthique et nos efforts communs pour en généraliser le respect sont inexplicables par la loi darwinienne de l’évolution des espèces ; elle en sont même la négation évidente. Pourtant, nous affirmons – au risque de passer pour des naïfs marginaux – son importance pour le progrès de notre espèce, voire pour sa survie.
Et voici un deuxième exemple. Il est de plus en plus évident que la technoscience est aujourd’hui en compétition directe, voire en opposition déclarée, avec la nature en tant que nouveau moteur de l’évolution de notre espèce. Même sans succomber aux discours des gourous utopistes, nous allons devoir admettre de plus en plus que l’invention des technologies numériques déclanche une révolution anthropologique aussi marquante que la maîtrise du feu en son temps (3). L’âge du numérique dans lequel nous entrons, et dont nous ne comprenons encore que les prémisses, annonce aussi ce qu’on peut appeler l’anthropocène : l’âge de l’homme. Plusieurs spécialistes veulent dire ainsi que notre planète porte désormais la signature de notre espèce, dont l’activité transforme désormais les paramètres plus que ne le font la géologie, la météorologie et tous les autres déterminants naturels. Les technologies numériques nous permettent de développer de nouveaux paradigmes : la nature, la vie, l’intelligence et la mémoire artificielles. Nous passons de la domination de la biosphère à des utopies numériques. Je ne suis certes pas de ceux qui proposent de généraliser la loi de Moore (la puissance, la mémoire et la vitesse de nos ordinateurs doublent tous les dix-huit mois) à l’évolution humaine. Mais nous pourrions affirmer que ce n’est plus Dieu, ni la Nature qui expliquent notre évolution. Le numérique remplace la Nature aussi bien que Dieu. Devons-nous mettre une majuscule au numérique et en faire une nouvelle religion, comme plusieurs prêcheurs actuels ? Dieu nous garde de toute religion et de leurs faux prophètes, même s’ils sont reconnus et célébrés à l’envi. Les êtres humains faibles d’esprit ont toujours tendance à renoncer à leur liberté de pensée et à leur dignité, pour s’en remettre à une intelligence supérieure, qu’elle soit naturelle, divine, ou aujourd’hui artificielle.
Mais il serait tout aussi ingénu de nier que le numérique provoque aujourd’hui une transformation accélérée de nos structures mentales, psychiques, cognitives et sociales. Nous passons manifestement de la rigidité à la flexibilité de la pensée, du raisonnement linéaire à la configuration en arabesque, de la causalité à la sérendipité. Notre syntaxe est devenue associative, comme les idéogrammes chinois. Dans nos bibliothèques virtuelles, nous avons remplacé nos tiroirs à fiches alphabétiques par des moteurs de recherche traquant à haute vitesse les hyperliens. Les classifications aristotéliciennes par catégories et ensembles ont cédé la place aux liens et aux hyperliens. Nos modes de communication individuelle et sociale sont en pleine mutation eux aussi. Nous passons d’un monde basé sur le temps lent et répétitif, sur la mémoire et l’expérience, à un monde caractérisé par la fragmentation, la vitesse et l’agitation. Ce sont certes de nouveaux concepts psychologiques, sociaux et physiques difficiles à cerner et manipuler du point de vue épistémologiques, mais nous devons relever ce défi. Nous entrons dans le postrationalisme (4). Nous pouvons parler d’un mouvement social brownien des particules, tout autant que de société de masses et de globalisation. C’est ce que j’ai appelé la conscience impressionniste de notre image du monde et de notre conscience sociale. Dans ce désordre, voire dans ce chaos, c’est par association d’individus (petits groupes) et par association d’idées, que nous pensons et que nous vivons, donc par liens et hyperliens. À cet égard, le web n’est pas seulement un exemple évident de notre nouveau mode de pensée et de communication : c’est la métaphore même de notre monde contemporain, si paradoxal : écranique, irréel et trop réel, fragmenté et global, chaotique et contraignant, ludique, euphorique et incontrôlable, où nous tentons de construire du sens et des valeurs et de nous orienter au hasard de mos navigations. S’orienter n’est aussi qu’une métaphore : c’est regarder vers l’orient, du côté où la lumière se lève. Et nous sommes devenus dépendants de la lumière bleutée de nos écrans.
Nous vivons de plus en plus sur une planète hyper. Il nous faut passer de la solitude à la solidarité des liens. Nous redécouvrons ainsi le sens de la morale confucéenne, celle des liens sociaux, qui fait écho aux liens des idéogrammes. Nous prenons ainsi conscience de la nécessité d’une éthique planétaire. Une éthique qui est la base de l’hyperhumanisme auquel nous aspirons et qui devient plus important que la technoscience elle-même comme moteur d’évolution de notre espèce – et sans doute même pour sauver notre planète et notre espèce de l’auto-destruction. Je n’ai pas de doute que la technoscience va poursuivre glorieusement sa lancée, selon sa propre logique de compétition intellectuelle, commerciale et politique. J3e n’ai donc pas d’inquiétude pour elle et il n’y a pas lieu de la défendre, du moins dans la pensée occidentale. Il n’en est pas de même de la morale planétaire, qui a tant de mal à s’imposer dans les esprits. En évoquant une planète hyper, je dis hyper tout à la fois pour souligner l’augmentation de la conscience humaniste dont nous avons besoin et pour reconnaître l’importance des hyperliens comme structures mentales, psychiques, cognitives et sociales.
En ce sens, le web n’est pas qu’un instrument, ni seulement une métaphore pour penser le monde. Il devient aussi un laboratoire populaire, partagé, d’informations, d’échanges, de solidarités, de conscience et d’innovation. Voilà une technologie qu’on pourrait qualifier de triviale, et qui constitue pourtant une divergence majeure en soi ; plus encore : elle devient un outil de progrès humain et finalement d’hyperhumanisme.
Le génie de Darwin était grand. Aujourd’hui, il penserait l’évolution en numérique et en création humaine.
Hervé Fischer (5)
_________________________________________
(1). Voir La société sur le divan, vlb, Montréal, 2007.
(2 ) Voir Nous serons des dieux, vlb, Montréal, 2006.
(3) Voir Le choc du numérique, vlb, Montréal, 2001.
(4) Voir La planète hyper. De la pensée linéaire à la pensée en arabesque, vlb, 2003.
((5) Cette conférence a été donnée lors du Webcom, le 13 mai 2009.
lundi, avril 13, 2009
La dynamique constructive des rêves

Comment ne pas être interpellé par le désordre des rêves, qui surprennent sans cesse le dormeur. C’est bien notre cerveau, le même cerveau, qui improvise les story-board de nos rêves, ses effets de surprise et nos réactions d’acteur. D’où tient-il ce pouvoir évident de se prendre lui-même au dépourvu à chaque instant par des rencontres, des épisodes, des dénouements qui nous paraissent totalement inattendus, incongrus ou puissamment créatifs? Nous vivons nos rêves comme la vie, selon des scénarios qui surgissent sans préavis et auxquels nous tentons de nous adapter. Mais les rêves apparaissent encore plus indépendants de notre contrôle. Nous avons le sentiment qu’ils sont créés par un autre que nous-même, comme si le rêveur se dédoublait en un metteur en scène habile à nous surprendre et un acteur désemparé.
Sommes-nous aliénés à nous mêmes dans nos propres songes, manipulés par des esprits malins? Il ne faut pas s’étonner que la tradition humaine les ait donc souvent interprétés comme des messages des dieux, qui profitent de notre sommeil pour communiquer avec nous. Comment notre propre cerveau peut-il disposer d’une telle autonomie inventive par rapport à nous-même et inventer deux rôles simultanés? D’où tient-il cette dynamique infatigable de construction narrative? Comment se construit l’écart entre notre conscience de rêveur et les événements qui nous assaillent dans le sommeil?
Ces questions m’ont longtemps laissé sans réponse. Au-delà de la littérature ésotérique, je n’ai pas trouvé d'explication dans mes lectures. Mais j’ai toujours eu le sentiment que la compréhension de ce phénomène si étrange serait de grande importance pour analyser aussi notre fonctionnement cérébral diurne.
Et peut-être l’insistance que j’y ai mis a-t-elle favorisé une intense activité de rêveur, que je me suis plu à interrompre souvent par des réveils intempestifs qui me plongeaient chaque fois dans cette même stupeur : le sentiment absurde qu’un autre que moi-même se jouait malignement de moi dans mes rêves.
Les psychanalystes invoquent une syntaxe et des « logiques de l’inconscient », hétérogènes à notre logique rationnelle de vie diurne, qui fonctionneraient à notre insu dans le rêve, en fonction de notre mémoire, de nos inquiétudes, de nos désirs, et nous soumettraient donc à une rencontre onirique, voire à une confrontation avec nous-mêmes (moi et surmoi. Ils appuient donc leurs interprétations du subconscient sur le récit des rêves. Encore faut-il pouvoir expliquer la gestation cérébrale des rêves, son autonomie spontannéiste et ses effets de surprise conçus en amont et aux dépens de la conscience du dormeur. Devrait-on dire que lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent?
L'apparente autonomie du rêve
Sans même recourir à une pratique clinique, plusieurs déductions s’imposent d’elles-mêmes.
La première, c’est que la conscience du rêveur ignore à quelles surprises le cerveau va le soumettre subrepticement. Autrement dit, la conscience humaine, de même que la mémoire ou la perception, dissimule, ignore ou censure beaucoup plus d’informations qu’elle n’en donne à connaître. Une conscience intégrale de tout ce qui entoure un être humain, une mémoire immédiate de tout ce qu’un être humain peut se rappeler, rendrait la vie impossible. On le sait : ne remonte à la conscience que ce qui est utile à la survie ou pertinent par rapport à la psyché. C’est manifestement ce même mécanisme de sélection et d’obturation de la conscience qui opère dans le rêve, mais beaucoup plus flexiblement.
La seconde déduction, c’est que les structures associatives et les règles syntaxiques de la conscience ont un pouvoir de construction du rêve beaucoup plus rapides et inventives que la conscience que nous en avons. Ce fonctionnement autonome est manifestement le même pour le cerveau que pour les autres organes du corps humain : le cœur, le foie, l’estomac, les poumons, etc. La gestation des idées, les connections qui se nouent, les conceptualisations qui se précisent en amont ou indépendamment de notre conscience sont non seulement sont très rapides, mais aussi beaucoup plus foisonnantes et multiples que le résiduel que nous en retenons. Nous sommes loin d’être conscients de toutes les idées, intuitions, associations d’idées et d’images que notre cerveau génère. À cet égard encore, les arguments d’utilité pour la survie ou de sélection selon nos intérêts psychiques prévalent.
La troisième déduction, c’est que les structures élémentaires d’association ou d’enchaînement des idées et d’agrégation des images constituent une matrice puissante du cerveau, en constant fonctionnement, à l’état de veille comme dans le sommeil, qui activent sans cesse des connections neuronales, que nous sélectionnons dans la vie diurne consciemment, et dans le rêve inconsciemment.
De ce moulin à images et à idées, mu par la centaine de milliards de neurones (10 puissance 11) stimulant les synapses du cerveau, notre conscience ne capte qu’un mince affleurement filtré par la grille sélective de nos besoins et de nos sentiments les plus immédiats. Toutes ces connections se sont construites durablement au moment où l’enfant élabore sa perception et son interprétation du monde. Elles sont donc élémentaires et puissantes comme une matrice biologique du cerveau humain. Le cerveau, comme nos autres organes, ne cesse de fonctionner, quasiment dans un état neurovégétatif, et de produire des milliers de connections synaptiques toujours disponibles pour être réactivées par la mémoire, par l’intelligence ou par le rêve. Ce bouillonnement souterrain – je choisis ici la métaphore de la profondeur – est puissant et chaotique, comme le continent irrationnel sur lequel surfe notre conscience diurne. C’est ce que nous suggère le processus du rêve. En recourant à une autre métaphore, celle de la lumière, je dirai que le rationnel est un léger glacis lumineux de la plus grande importance vitale, stratégique et humaniste sur un océan neuronal obscur et en constant remous.
La conscience ne sait pas qu'elle rêve
La quatrième déduction, c'est que face au surgissement des associations obscures d'images et d'idées que lui présente le cerveau, la conscience du rêveur se présente comme une conscience semi-diurne, comme un semi-éveil, favorisant le réflexe de tenter de reprendre le contrôle sur le spontanéisme pulsionnel, qui nous apparaît comme un désordre de connections existantes.
Allons plus loin. Le rêveur a le sentiment d'être éveillé. Sa conscience ne sait pas qu'il rêve lorsqu'il est confronté à diverses situations de routine, agréables ou cauchemardesques dans ses rêves. Comment est-il possible que la conscience se trompe elle-même? Comment se fait-il qu'elle soit à ce point trompée par l'irréalité du rêve? Faudrait-il croire que la conscience en veille soit elle-même trompée au même degré par la réalité et que la vie n'est qu'un rêve - ou un cauchemar? "Mords-moi pour que je sois sûr de ne pas rêver..." La différence entre le rêve et la réalité peut paraître infra-mince. Comment établir la distinction avec certitude? Cela semble impossible! Au coeur du rêve le rêveur croit tout autant que l'homme éveillé à la réalité de ses sensations, de ses émotions, des ses stratégies d'action. Les rétroactions et les surprises semblent tout aussi réelles dans les deux situations. Cette problématique a souvent été évoquée dans la littérature philosophiques aussi bien qu'onirique. On notera cependant que les émotions, les angoisses, si non les plaisirs sont plus forts, se bousculent à un rythme plus rapide dans le rêve que dans la réalité habituelle. Peut-être pourrait-on dire que dans le rêve les émotions créent une réalité plus intense, plus dramatique. Tandis que dans l'état de veille la réalité usuelle crée plus lentement des émotions. La gestation est inverse et son rythme différent.
Peut-on dire que ce qui distingue le rêve de la réalité ce serait la forte contrainte de la logique et la stabilité des perceptions dans la réalité ordinaire, alors que dans le rêve ordinaire la logique est constamment bousculée, surprise, dans des situations successives volatiles. Logique et stabilité seraient deux attributs usuels de la réalité, que le rêve ne respecte pas. Il y aurait finalement une différence de degré et non de nature entre l'éveil et le rêve? Comme dans le cas de la maladie mentale par rapport à la lucidité du principe de réalité? De l'effet d'une drogue par rapport la conscience "normale"?Nous savons bien que non. Mais en quoi finalement consiste cette différence et sa crédibilité? Quelles "normes" définissent la "normalité" et toutes ses variations? Devrait-on se résoudre à se contenter d'un descriptif? D'un cahier des charges? Le policier demande au conducteur dont il soupçonne l'ivresse de marcher sur une ligne droite. Ne peut-on pas faire mieux dans la distinction entre la conscience que nous avons de la réalité et la conscience qui croit son rêve réel?
Il y a là une problématique qui appelle à des recherches persévérantes.
L'écrivain Jean-Paul Rolland, en traitement dans un Centre de soins psychiatriques de La Chesnaye, près de Paris, écrit dans la Lettre à Mathilde, ou LA MAIN DE DIEU:
Je cherche l'escalier de marbre blanc et mon imagination fiévreuse monte pas à pas jusqu'au
premier étage; silencieusement j'ouvre les mille portes prestement...
QUELLE DÉCONVENUE !
Que les Indiennes sont frigides et peu loquaces, j'ai rencontré quelques entrejambes,
quelques formes intéressantes... mais tout ça n'étais pas sérieux... je cache encore quelques
dessins dans mes tiroirs de fabrication artisanale... *
L'auteur écrit, il choisit ses mots; il est conscient du pouvoir de son imagination et des mots qui en créent l'illusion. Mais ce sont des expériences réelles de situations irréelles qu'il évoque. Comment fait-il, comment faisons nous ce que nous pourrions appeler "la part des choses"? Peut-on comparer les mécanismes du rêve, ceux de la maladie mentale et ceux de l'intoxication par une drogue? Je n'en doute pas. Mais le rêve n'est pas l'effet du molécule chimique. La maladie mentale l'est-elle? Les psychiatres le pensent. Les psychanalystes non.
Ce sont là des observations et des questions de la plus grande importance sur le fonctionnement du cerveau humain.
Hervé Fischer
* Jean-Paul Rolland, La Lettre à Mathilde, ou LA MAIN DE DIEU, 2009, édition Petite Capitale, Paris, p. 116
mardi, février 24, 2009
Mythanalyse du capitalisme III
Nous sommes attachés à la démocratie politique et l’avons consolidée peu à peu dans plusieurs pays. La démocratie est un mythe actif de fondation de nos sociétés occidentales actuelles. Il est laïc et égalitariste. Il prévaut en politique, mais le monde financier l'ignore ou le rejette encore pour faire prévaloir ses privilèges archaïques. La justice appartient à cette même constellation mythique de la démocratie. Elle est réaffirmée constamment et encore plus souvent bafouée. Nous rencontrons là, cependant les deux mythes sur lesquels repenser et réorienter le capitalisme.
Mais dans ces mêmes pays, dits modernes, nous en sommes encore au stade du féodalisme dans l’économie et les finances. Les terribles effets pervers de ce décalage historique nous apparaissent clairement dans la crise actuelle. L’histoire nous rappelle que les seigneuries du Moyen-Âge, puis les aristocraties qui en sont nées, ont su maintenir leur emprise politique pendant des siècles. Il a fallu des révolutions pour leur arracher leur pouvoir et construire, par à coups, les démocraties politiques actuelles, encore très imparfaites. Il est certain qu’il ne faut pas attendre davantage des princes de la finance et de l’économie qu’ils renoncent aujourd’hui spontanément à leurs privilèges et se réforment d’eux-mêmes. Cela prendra encore de nombreuses turbulences, telles celles de 1929 et de 2008. Et ce sont les institutions politiques élues par les masses qui seules pourront venir à bout de cet anachronisme et de ses conséquences dramatiques. Les petits épargnants d’aujourd’hui sont manifestement les serfs et la chair à canon des rois de la spéculation qui règnent sur notre économie financière, comme jadis les paysans se faisaient systématiquement exploiter par les seigneurs. Le nouveau président américain a posé des gestes symboliques à cet égard en plafonnant les salaires des grands argentiers et chefs des entreprises que l’État a sauvés de la faillite avec l’argent des contribuables.
L’économie néolibérale a montré les mêmes abus de pouvoir qui sévissaient sous le régime féodal du Moyen-Âge: les privilèges exorbitants, l’exploitation des faibles, le secret, le fait du prince, le cynisme, l’arrogance, le racket, la prédation, la violence ordinaire. Ces outrances ont été telles qu’elles ont délégitimisé le capitalisme libéral, comme les excès du socialisme soviétique en ont ruiné les possibles vertus. On pourra établir un parallèle avec 1989 et se demander si ce capitalisme sans retenue, libéré de l’hypothèque du communisme, n’a pas rencontré à son tour, vingt ans plus tard, son mur de Berlin – disons son mur de Wall Street.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les actifs bancaires perdus depuis un an sont évaluées à 2200 milliards de dollars; le président de News Corp a estimé, à l’occasion du Forum de Davos, que 50 000 milliards d’actifs de patrimoines individuels seraient partis en fumée. Aux États Unis, le gouvernement aura, selon les chiffres qui circulent, versé quelques 8000 milliards en moins d’un an pour secourir les grandes banques, les assurances et les entreprises notamment dans le secteur de l’automobile. Et cela n’aurait pas empêché les financiers américains responsables de cette catastrophe d’empocher des bonus de 150 milliards depuis cinq ans. Mieux : en pleine crise, ils ont continué à s’accorder mutuellement des bonus exorbitants directement pris dans les fonds de secours offerts par l’État américain. On a même pu observer la difficulté du président Obama à trouver des collaborateurs de haut calibre ayant acquitté tous leurs impôts. Selon les dernières prévisions du Bureau International du Travail, la crise mettra plus de 50 millions de personnes au chômage dans le monde, pour un total de 80 millions de chômeurs, qui pourrait monter jusqu’à 200 millions si la crise dure – une évaluation officielle qu’il faut multiplier au moins par deux pour avoir un estimation réaliste des sans emplois et par cinq pour chiffrer le nombre des êtres humains vivant dans une extrême pauvreté. La dérégulation, un endettement généralisé et une consommation effrénée, l’économie imaginaire et les folies financières des États-Unis nous ont conduit au seuil de la déraison et de turbulences sociales et politiques qui pourraient aggraver encore la situation mondiale.
Bien sûr, la solution ne consiste pas à diaboliser le capitalisme, qui prône la liberté d’entreprendre nécessaire à la création de richesses, et qui demeure assurément la moins pire des idéologies. Mais encore faut-il revenir à son esprit fondateur ou, l’adapter à l’éthique actuelle des classes moyennes. Alan Greenspann, lorsqu’il était président de la Réserve fédérale américaine, avait souligné les risques d’une « exubérance irrationnelle » de l’économie. Et tandis que le Président Obama dénonce la cupidité "honteuse" de plusieurs financiers et entrepreneurs nord-américains, il est bon de rappeler ces mots de Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme: "L'avidité du gain sans limite n'a rien à voir avec le capitalisme, et encore moins avec son esprit. Le capitalisme s'identifierait plutôt à la domination, à tout le moins à la modération rationalisée de cette pulsion irrationnelle". Et il souligne que ce capitalisme repose sur une attitude pacifiste favorisant les échanges, plutôt que sur la conquête, l'exploitation, le cynisme et la violence. Il souligne que c'est son éthique qui a d'abord fondé son succès. Autrement dit, si nous voulons en finir avec les prédateurs et les escrocs du capitalisme déréglé, les justiciers et les Robin des bois ne suffiront pas à la tâche, qui est colossale. Il faut remettre à l’ordre du jour et instituer un certain rationalisme économique, avec les mêmes exigences qui prévaut dans les règles de la démocratie politique. La démocratie ne peut pas être seulement politique. Elle doit aussi être économique et financière. Si non elle n’existe pas réellement.
Certes, nous savons qu’une volonté excessive de rationalisme économique conduit à des effets pervers. Le socialisme économique qui ne dit pas son nom, comme en France, et les excès bureaucratiques qu’il implique, cassent la créativité économique et créent le chômage, au nom de la justice et de la protection sociales. Que ce soit en politique ou en économie et en finance, la démocratie n’est pas facile à définir et encore moins à pratiquer. Du moins exige-t-elle une certaine transparence des pratiques et de l’information, une égalité des droits et une représentativité des citoyens, un équilibre des pouvoirs, une discipline et des sanctions, un rythme de renouvellement des dirigeants en place : autant de principes qui finissent par converger vers un mode de fonctionnement plus prudent et plus équitable. Seuls ces principes nous permettront de sortir du féodalisme actuel, de sa liberté dévoyée, et de construire peu à peu des règles, des usages et des mœurs économiques et financières démocratiques. Or il est clair qu’au nom du néolibéralisme, nous avons évolué depuis quelques décennies, exactement dans la direction opposée. Nous avons fait confiance à la loi de la jungle économique. En cette année où nous célébrons le bicentenaire de la naissance de Darwin, nous constatons que beaucoup d’Américains, notamment ceux qui votent républicain, sont paradoxalement créationnistes en religion et darwinistes en économie. Or aujourd’hui, l’heure n’est plus au darwinisme économique. La nature ne connaît pas la morale. La solution n’est pas dans l’adaptation, mais dans la divergence, qui consistera à instituer la même éthique démocratique en économie et dans les finances, que nous exigeons en politique. Cela ne se fera pas en un jour, mais nous devons le faire.
Hervé Fischer
dimanche, février 22, 2009
Mythanalyse du capitalisme II
II - Le capitalisme catholique conflictuel

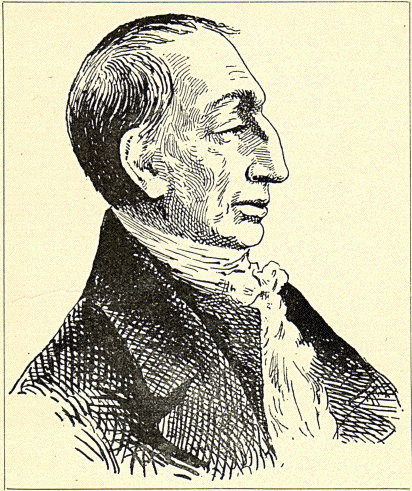

La bourgeoisie, elle, travaille, pour acquérir un statut social, mais elle finit par renverser la royauté trop conservatrice. La Révolution française lui permet d’acquérir à bas prix les biens de l’église et de l’aristocratie qui ont été confisqués. Et elle cherche à son tour à développer un capitalisme industrieux et financier, sous le signe du saint-simonisme. C’est sans compter avec les révoltes du peuple, dessaisi des conquêtes de la Révolution, plus exploité que jamais, et qui trouve ses maîtres à penser avec Proudhon et Marx. En pays catholique, le capitalisme demeure frappé par un profond sentiment originel de culpabilité, comme en témoigne l’influence d’un Lamennais. Freud lui-même identifie l’argent au stade annal du développement de l’enfant (accumulation, rétention, thésaurisation improductive et conflits), qu’il tend à généraliser au capitalisme lui-même. Bref, le capitalisme européen, malgré la compétition du capitalisme de la Réforme qui triomphe en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas et surtout aux États-Unis, demeure profondément divisé en Espagne, au Portugal, en Italie en France. Alors qu’il est identifié au mythe du Nouveau Monde, sous le signe de la liberté, de l’égalité des chances, du bonheur et de la création de richesse en Amérique du Nord, en Europe catholique, le capitalisme est considéré par beaucoup comme destructeur de la société et de la nature. Les mouvements de gauche y voient l’origine de l’inégalité de l’exploitation du prolétariat, de la violence et de la guerre (Thanatos). Il manque de légitimité mythique, il ne se réconcilie pas avec lui-même. Et cette ambiguïté se reflète dans les perpétuelles révoltes populaires, souvent sanglantes, les grèves générales, les conflits sociaux endémiques qui divisent la société depuis lors et jusqu’à nos jours, particulièrement en France. Cela se traduit en Europe par un encadrement de plus en plus étroitement bureaucratique du capitalisme par l’État, à qui on confie la tâche de répartir plus égalitairement la richesse, de protéger les exploités, et finalement de limiter les excès naturels du capitalisme qui aboutiraient à des fractures sociales dangereuses. Cette théorie keynésienne de l’économie, en quête d’équilibre social, triomphe d’ailleurs paradoxalement aujourd’hui aussi aux États-Unis en proie à la pire crise depuis 1929. Le président Obama demande l’intervention massive de l’État en faveur des victimes et des démunis, au grand dam des Républicains ultralibéraux, confiants dans leur tradition, et au risque d’un endettement fatal pour l’avenir du pays.
On le voit bien, le mythe triomphant du capitalisme créateur de richesse, légitimé par la religion réformée, qui a assuré la prospérité américaine, n’a jamais pu s’accommoder des valeurs mythiques de religion catholique, ni en Amérique latine où les espaces à conquérir étaient aussi grands et prometteurs, ni en Europe. Mis en doute perpétuel, soumis à des conflits idéologiques et sociaux incessants, entaché de culpabilité, identifié à la destruction de la société et de la nature, il est remis régulièrement en question et aujourd’hui plus que jamais au vu de la crise américaine. Au moment où beaucoup parlent donc d’une « refondation du capitalisme », nous constatons une fois de plus que le capitalisme n’est pas seulement une administration des affaires et des finances, qui garantirait une compétition équitable : il a partie liée avec nos mythes fondateurs les plus ancrés dans notre civilisation : la religion. Un renforcement de la bureaucratie de la justice de répartition ne suffira sans doute pas à créer une nouvelle dynamique de prospérité. Les vieux mythes semblent décrédibilisés. Il faut imaginer d’autres mythes fondateurs de la vie en société. Penser autrement. Diverger. Inventer un autre opérateur universel de valeur que l’argent. Beaucoup y travaillent, mais c’est la tâche la plus difficile et incertaine qui se puisse concevoir. Seule la démocratie et l’éthique planétaire ont aujourd’hui une puissance mythique suffisamment fondée et partagée et pour nous permettre de nous orienter vers une économie équitable, soumise aux mêmes exigences de démocratie que la politique.
Hervé Fischer
jeudi, février 05, 2009
Mythanalyse du capitalisme I
 I - Le capitalisme consensuel de la Réforme
I - Le capitalisme consensuel de la RéformeLa religion de l'argent a d'abord été étroitement associée à celle de Dieu, comme l'a montré Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est donc à Max Weber que l'on pense d'abord dans toute tentative de construire une mythanalyse du capitalisme. Dans la période de crise actuelle , où l'on accuse la cupidité "honteuse" des financiers et des entrepreneurs nord-américains, il est bon de rappeler cette affirmation de Max Weber dans l'avant-propos de son livre: "L'avidité du gain sans limite n'implique en rien le capitalisme, bien moins encore son esprit. Le capitalisme s'identifierait plutôt à la domination, à tout le moins à la modération rationalisée de cette pulsion irrationnelle". Et il souligne que ce capitalisme repose sur une attitude pacifiste favorisant les échanges, plutôt que sur la conquête, l'exploitation, le cynisme et la violence. Il souligne que c'est son éthique qui a d'abord fondé son succès. La violence, que seul l'État peut légitimement exercer, ne peut être employée que pour défendre Dieu, comme dans l'islam, ce qui justifie les guerres de religion.
Mais il faut distinguer le capitalisme anglo-saxon, d'origine protestante et son adaptation catholique, plus tardive. Certes, tous deux se réclament de la liberté d'entreprendre et de la création de la richesse, supposée être la clé de tous nos projets. Né avec la montée de la bourgeoisie postrévolutionnaire et saint-simonienne, le capitalisme s'accorda d'abord mal avec le catholicisme, qui prétendait mépriser l'argent et cultivait l'oisiveté aristocratique. Alors que dans l'esprit du capitalisme inspiré par la Réforme, c'est au contraire le travail qui est créateur d'argent et de progrès. Autrement dit, le capitalisme de la Réforme est plus proche du mythe grec de Prométhée fabricateur, travailleur et entreprenant que le capitalisme catholique. Le capitalisme anglosaxon est pieux et légitimé par dieu. Il n'en est rien du capitalisme de l'Europe occidentale catholique. Et c'est cette différence, qui a donné lieu à un décalage historique et de performance entre le capitalisme catholique et le capitalisme protestant que nous étudierons d'abord dans notre prochain texte.
Hervé Fischer
_________________________
* Max Weber L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, 1905.
lundi, février 02, 2009
Mythanalyse des liens - III
Aujourd’hui, dans nos sociétés de masses et de réseaux, chacun de nous est identifié par un numéro, qui relève de la même idéologie instrumentale de gestion que les produits que nous consommons. Chacun a son ADN identitaire. Chacun se situe à l’intersection de réseaux d’influence, qui le lient aux autres, à des sources d’information, à des systèmes de contrôle et d’influence. Chacun est traversé par les réseaux sociaux que/qui tissent les masses.
Je ne peux me penser moi-même comme une monade, sans porte ni fenêtre, comme disait Leibniz. Chacun de nous est un ensemble de réseaux entrecroisés : biologique, chimique, énergétique, matériel, historique, culturel, social, psychologique, numérique, etc. Les sciences humaines, comme celles du vivant ne disent pas autre chose et ne cherchent pas autre chose. Ma pensée, ma recherche artistique et mon écriture explorent et élaborent des liens. C’est ce que souligne le préfixe HYPER, si emblématique de notre époque. Hervé Fischer
dimanche, février 01, 2009
Mythanalyse des liens - II
Ce lien familial élémentaire est la base de la magie, comme des mathématiques et de l’informatique. Il est le fondement de la cybernétique autant que de l’alchimie, de la psychanalyse autant que de la mécanique quantique, de la sociologie autant que de l’histoire, de la folie autant que du rationalisme.
Cette matrice élémentaire a donc varié considérablement selon les époques et les sociétés. On en retrouve tous les effets dans la diversité des politiques, des religions, des sciences et des arts. C’est à ce niveau de l’inconscient mythique de notre société, qu’on repère les liens fondamentaux de l’homme d’aujourd’hui avec le monde qu’il interprète. C’est dans l’analyse de ces mythes actualisés qu’on déchiffre les logiques de liens qui structurent notre image du monde. En ce sens, on pourrrait dire que Confucius a été le fondateur de la pensée chinoise, et Aristote celui de la pensée occidentale, l'un survalorisant les liens, l'autre les catégories. Il y a des résonances directes entre familles indivises, conjugales, éclatées, reconstituées, et nos cosmogonies, nos religions. La révolution copernicienne fut aussi une révolution politique. Le passage de la logique de participation (magique) à la logique identitaire (individualiste et rationnelle), puis è la dialectique, aux logiques quantitatives ou aux logiques floues d’aujourd’hui reflètent l’évolution historique de la matrice familiale. La relativité einsteinienne en est l’exemple par excellence.
C’est là qu’il faut chercher l’origine des polythéismes comme des monothéismes, de la magie comme de la science rationaliste, de la providence comme de la théorie des cordes en astronomie. Et la mise en évidence du type de lien invoqué est aussi sans doute le meilleur analyseur de l’histoire de la musique ou de l’architecture, de la peinture ou de la danse. Et il en est de même de l’évolution depuis nos astronomies centrées jusqu’à des astrophysiques éclatées, de notre hésitation entre un big bang unique et une multiplicité de big bangs de notre univers.
Les métaphores actuelles, qu’il s’agisse des réseaux numériques, des hyperliens, de l’hypertexte, de ce que j’appelle l’hyperweb ou l’hypernature, reposent sur un renouvellement et une célébration des liens. Dans La planète hyper, j’ai tenté d’analyser l’impact des changements de structures mentales, qui nous font passer de la pensée linéaire à la pensée en arabesque. J’ai fait le tour des diverses logiques, qui sont autant de systèmes institués pour gouverner les relations entre les objets et entre les êtres, et montré l’importance des nouvelles logiques des liens qui s’affirment aujourd’hui, y compris celles des chaos, de la sérendipité, de l’innovation, des masses ou du numérique, ou plus simplement des mœurs et de la politesse ordinaire. La mythanalyse - qui, à la différence de la mythologie, est l’analyse des mythes actuels – souligne le parallèle qu’on peut établir entre l’inconscient d’un individu et celui d’une société. L’inconscient individuel est une déclinaison de l’inconscient collectif, où il puise ses images et ses structures. On ne peut pas mettre une société sur le divan, mais on peut analyser son histoire, ses événements heureux et malheureux, ses désirs et ses frustrations, ses traumatismes, comme on analyse la biographie d’un patient individuel. L’inconscient d’un individu, tel que Freud a tenté d’en préciser la nature, demeure assez insaisissable et obscur. En revanche, le mythanalyste repère facilement, malgré le brouhaha médiatique, ou bruit social, les productions culturelles, les institutions religieuses et politiques, les idéologies providentialistes ou progressistes, qui sont l’expression même de l’inconscient d’une société. Il semble que la plupart des gens ne s’étonnent pas de l’étrangeté de ces mythes, qui déterminent leurs valeurs et leurs comportements. Par exemple, les croyants prennent leur imaginaire religieux pour la réalité. Ils jugent normal de voir des églises, de participer à des rituels. Ils sont inconscients que ces fabulations instituées par leur société relèveront un jour autant de la mythologie que les croyances et rites des Égyptiens ou des Grecs anciens, ou d’une société amazonienne qu’ils qualifient pourtant de « primitive ». Ils n’ont pas conscience que le progrès technologique, dont nous sommes aujourd’hui obsédés, relève du mythe grec de Prométhée, qu’il en est même l’actualisation forcenée. Ils ne voient pas la contradiction entre Prométhée et Dieu, les deux grands mythes fondateurs de l’Occident, qui suscitent encore d’immenses tensions dans nos sociétés actuelles. C’est au niveau de ces liens, que se situe l’inconscient d’une société, et donc l’origine de ses déséquilibres ou de ses forces créatrices. Je ne parle pas ici d’érudition mythologique, mais de nos imaginaires modernes, de nos débats de société actuels et de nos utopies les plus répandues.
Nous n’avons pas davantage conscience que nos mythes familiers sont des déclinaisons de la matrice familiale, que j’évoquais plus haut. Car toute mythologie ancienne, comme tout système de mythes actuel, est une histoire de famille, à laquelle nous adhérons d’autant plus qu’elle réactive inévitablement nos émotions d’origine, nos sentimentalités archaïques de nouveau-né. Prométhée évoque le conflit avec Zeus - le père –, dont il dérobe le feu pour le donner aux hommes. J’ai souligné dans CyberProméthée, l’instinct de puissance, que Prométhée est aussi important qu’Éros et Thanatos, analysés par Freud. Il exprime la victoire des hommes sur leur dieu. Inversement, la figure mythique du dieu biblique exprime une soumission totale au père, que l’homme se doit d’adorer, au nom duquel il s’accuse, se flagelle, s’agenouille, et dont il espère en retour de sa courtisanerie obséquieuse, le paradis éternel. Étrange calcul, pari fou, en fait assez douteux!
Hervé Fischer
samedi, janvier 31, 2009
Mythanalyse des liens - I
Amoureuse ou d’affaire, internationale ou personnelle, physique ou spirituelle, morale ou politique, la relation engendre. Elle a d’ailleurs toujours été sexuée, et c’est là qu’il faut en chercher l’origine, qui est biologique et mythique. Car en amont même des théories ontologiques, scientifiques ou sociales, de Pythagore à Giordano Bruno et à Newton, de Hegel à Husserl, qui en ont voulu prescrire les structures, le lien naît d’abord dans la matrice familiale. C’est la relation du nouveau-né avec sa mère et son père, et à travers eux avec la société, qui fonde le lien, comme expérience vivante. Notre matrice mentale, cette structure intériorisée des relations selon lesquelles nous pensons le monde et établissons la correction, la légitimité ou la vérité de nos jugements, nous vient directement de la matrice familiale. Toute logique est d’abord bio-logique. Cette structure élémentaire, parce qu’elle est une expérience vécue, est incarnée dans notre cerveau. Elle prend statut de nature ou d’évidence, dont nous ne sommes plus conscients lorsque nous pensons, lorsque nous jugeons, lorsque nous créons et agissons. Mais parce qu’elle est liée aux émotions du nouveau-né, incluant son anxiété alimentaire quotidienne, elle est devenue une énergie, une nécessité vitaliste. Il s’agit d’un inconscient structurel, qui est d’origine biologique, avant même d’être formaté par la matrice sociale.
Vient notre éducation – au sens d’une deuxième naissance – , qui est profondément ancrée dans la société où nous venons au monde. Les valeurs et les comportements de la mère et du père sont inscrits dans la matrice sociale à laquelle ils appartiennent. L’étude des variations historiques de la logique montre que ses structures sont en résonance régulière avec les évolutions sociales, notamment en ce qui concerne les transformations des structures et idéologies familiales.
Nous dirons, inversement, que le monde vient à nous sous une forme, selon une structure, une logique qui sont le reflet direct de cette structure familiale élémentaire. La boucle est bouclée. Nous informons le monde selon les liens de la matrice familiale dans laquelle nous sommes formés et qui est elle-même le reflet des structures et des métaphores de notre société de naissance. S’en libérer, c’est diverger dans notre pensée, donc créer. Nous rejoignons là l’autre fondement de ma théorie : le rôle de la divergence dans l’évolution, par opposition à l’adaptation darwinienne.
Hervé Fischer
(Ce texte est le premier d'une série sur la mythanalyse des liens. Il a été publié dans une première version par la revue Inter - art actuel, No 101, hiver 2008-2009)
jeudi, juillet 17, 2008
Le Québec 250 ans après une victoire
Les fêtes du quatrième centenaire de la fondation de Québec ont éclipsé le 250e anniversaire de la victoire de Montcalm sur les Anglais le 8 juillet 1758 à Carillon (aujourd'hui Ticonderoga dans l'État de New York). Heureusement! s'écrieront ceux que la grandiloquence des commémorations fait sourire. Carillon évoque pourtant la résistance, ce mythe identitaire qui nous aide à comprendre l'inconscient collectif du Québec actuel.
À partir de l'enquête qu'il a menée pendant l'automne 2007 auprès des lecteurs du Devoir sur l'identité québécoise, le philosophe Hervé Fischer a écrit un livre intitulé Québec imaginaire et Canada réel. Les 7000 réponses qu'il a reçues l'ont incité à réfléchir sur les rapports historiques et symboliques entre un peuple de langue française et l'Amérique du Nord anglophone qui enserre le territoire où il vit.Fischer souligne qu'une nation se définit «avant tout, et généralement pour des siècles», par «ses mythes fondateurs». En s'appuyant sur les contributions des lecteurs du Devoir, textes qui, en majeure partie, témoignent d'une sensibilité souverainiste, il constate que le Québec a des mythes fondateurs mais que le Canada anglais en est dépourvu.
Qui oserait le nier? L'Amérique du Nord britannique a emprunté à la langue française de la vallée du Saint-Laurent les noms mêmes de Canada et de Canadien dont les anglophones sont si fiers. Leur hymne national, Ô Canada, et le symbole de la feuille d'érable proviennent d'une vieille culture, celle du Québec, devant laquelle tant d'entre eux, d'Halifax à Vancouver, se sentent malgré tout étrangers.
Jadis très connu chez nous, le poème Le Drapeau de Carillon, d'Octave Crémazie, publié en 1858, 100 ans après la fameuse bataille, leur apparaîtrait comme du pur charabia. À leur décharge, il faut dire que ces vers, empreints d'un romantisme pathétique et suranné, resteraient également incompris d'un grand nombre de Québécois d'aujourd'hui.
Au milieu de l'amoncellement des clichés de Crémazie, une idée défie le temps: ce qui s'associe le mieux à la victoire de Carillon, c'est étrangement la mort, celle d'un vieux soldat canadien, porte-drapeau de l'armée de Montcalm. Après
«Pour mon drapeau je viens ici mourir», murmure le soldat, déjà devenu le fantôme qui mendie la revanche futile de l'histoire. Que nous ayons pu, jusqu'à
Michel Lapierre
Le Devoir, 19 juillet 2008
dimanche, juin 22, 2008
Québec imaginaire et Canada réel

samedi, avril 12, 2008

LE DEVOIR Édition du samedi 12 et du dimanche 13 avril 2008
Québec imaginaire et Canada réel
Hervé Fischer, Artiste-philosophe
Mots clés : société, Hervé Fischer, Culture, Québec (province)
En septembre dernier, Le Devoir a tendu la perche à ses lecteurs, les invitant à participer à l'enquête Québec imaginaire lancée par l'artiste-philosophe Hervé Fischer. S'emparant du contexte sociopolitique tout à fait unique dans lequel le Québec était alors plongé, M. Fischer vous posait deux grandes questions: «Qu'est-ce que le Québec réel?» et «Quel est votre Québec imaginaire?». Vous avez été nombreux à répondre, et tel que convenu, l'auteur a étudié patiemment l'ensemble des contributions reçues, rassemblant les plus riches dans un livre à paraître le 15 avril prochain. Dans Québec imaginaire et Canada réel. L'avenir en suspens (VLB éditeur), Hervé Fischer analyse les résultats colligés, y allant de sa propre synthèse, mise en relief avec un exercice semblable effectué il y a 25 ans. Nous publions aujourd'hui des extraits de son essai.
Ai-je voulu relever le défi de mettre le Québec sur le divan? J'ai en tout cas essayé de l'écouter attentivement, à travers ses médias et ses productions culturelles, notamment sa littérature, ses films et ses chansons. J'avais le sentiment très fort que le Québec évoluait rapidement. [...]
Le hasard du calendrier a fait coïncider mon enquête avec les séances publiques de la commission Bouchard-Taylor de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, qui a organisé 22 forums publics à travers le Québec au cours de l'automne 2007. J'en ai suivi le déroulement et les échanges à la télévision. Cette commission a suscité aussi tout un charivari médiatique de réactions individuelles et de nombreux groupes sociaux. Et c'est finalement de plusieurs centaines de réponses, de commentaires dans les journaux et de rapports mis sur le site de la commission Bouchard-Taylor que j'ai pu disposer pour préciser mon analyse. [...]
Tendances marquantes
J'ai le plus souvent cru devoir citer nominalement les auteurs des contributions dont je publie des extraits, car ils acceptaient d'avance que leurs textes soient diffusés avec la mention de leur nom dans le journal, sur le site «Québec imaginaire» du Devoir et dans le livre que j'annonçais. [...] J'ai tenté de m'inspirer d'une lecture attentive de ces contributions pour construire et orienter ma réflexion. Et je tiens à remercier sincèrement chacune et chacun de ceux, professionnels, étudiants ou retraités, qui ont ainsi directement contribué à ma recherche. Bien sûr, je n'ai pas pratiqué l'oecuménisme, mais plutôt tenté de dégager les tendances les plus marquantes. Ce livre est donc en quelque sorte une réponse collective et synthétique aux deux questions posées.
Ton optimiste
Et j'ai été étonné par le ton de ces contributions, en général beaucoup plus optimistes que celles de 1982. Le Québec a changé. Ne me devais-je pas d'y répondre à mon tour? J'ai donc tenté, en réfléchissant à ces textes, commentaires et suggestions que j'ai reçus, de les mettre en balance avec le discours collectif du Québec actuel et de les situer dans une interprétation plus générale. Ce livre est ainsi devenu aussi ma propre réponse. Je me suis interrogé plus particulièrement sur la fragilité du Canada, dont les Québécois ne semblent guère conscients et dont nos voisins anglophones semblent faire un sujet tabou, mais à laquelle je consacre un chapitre entier de ce livre.
J'ai fait le constat de l'attentisme actuel, aussi bien canadien que québécois, évidemment sans avenir, et qui ne nous laisse d'autre choix au Québec que de voter pour notre indépendance, afin de s'en dégager et de se redéfinir librement. Le contrecoup sera considérable pour le Canada lui-même, l'obligeant à négocier avec le Québec une nouvelle Union nord-américaine d'États indépendants. Au terme de cette analyse, il m'a paru nécessaire de préciser cette vision générale de l'avenir de nos deux pays, à partir de la façon dont ils se présentent à nous aujourd'hui, dans leur étrange relation de chicane perpétuelle, et tels qu'ils devront se refonder, pour incarner un nouvel espoir dans l'équilibre du monde.
Le pays imaginaire du Québec
Pays réel ou imaginaire? Chimère? Province? Nation? Nous? Souveraineté? Canada? J'entends si souvent autour de moi ces questions sur le statut ou l'existence même du Québec, explicites ou implicites, y compris dans le non-dit des conversations prudentes, qu'elles sont devenues pour moi aussi des questions incontournables. Je ne connais pas beaucoup de sociétés où la vie tourne autour d'un problème si étrange et j'avoue que je ne m'y suis pas habitué, même si je me suis laissé influencer moi aussi par cette idée gravée dans les esprits que le Québec souffre d'un mal identitaire chronique, aggravé par les deux défaites référendaires.
Quand j'ai choisi d'émigrer au Québec, au début des années 1980, la dépression collective, aggravée par la crise économique et l'échec référendaire, y paraissait désespérante. Elle se traduisait par une morosité blessée et défaitiste comme sous le joug de la fatalité. C'était le temps d'Hubert Aquin. Trou de mémoire. Neige noire. Blocs erratiques.
Et aujourd'hui, beaucoup de Québécois désabusés semblent encore penser que l'avenir se referme. Ils citent pour preuves, pêle-mêle, le déclin démographique et la difficulté d'intégrer rapidement les immigrants, le scandale des commandites, le vol des résultats du référendum de
Le Québec sur le divan
Bien sûr, la double question que je posais a suscité chez beaucoup une réponse opposant le réel et le rêve, tandis que d'autres ont surtout voulu exprimer leurs désirs. Mais tout pays n'est-il pas à la fois imaginaire et réel? Ne peut-on pas le dire aussi de ceux qui ont un siège aux Nations unies? Plusieurs répondants l'ont souligné. «Personne ne peut vraiment connaître ce qu'est le Québec réel; c'est toujours une affaire de perception qui relève certainement un peu de l'imaginaire», écrit André R. Bouchard.
Il serait très imprudent de sous-estimer le poids du réel. Ceux qui ne l'aiment pas ne peuvent nier à tout le moins sa résistance à nos désirs et sa charge de souffrance. Mais il ne serait pas moins téméraire de croire que nous le connaissons. Georgette Duchaine nous parle ainsi de son Québec: «Pour moi, il est réel quand je regarde le fleuve de la pointe de Saint-Vallier; quand je me promène dans le jardin des Ursulines du Vieux-Québec; quand, en avion, à
Réel et imaginaire
Notre connaissance du monde semble résulter d'un mélange dynamique d'objectivité et d'imagination; et ces deux éléments ne peuvent être isolés distinctement comme la molécule d'oxygène et les deux molécules d'hydrogène qui font l'eau. Bien plus: comment ne pas s'étonner de l'écart fabuleux qui nous apparaît entre cette formule élémentaire des particules chimiques et la puissance d'évocation de l'eau!
Il en est un peu ainsi d'un pays que l'on s'emploie à décrire selon des paramètres constitutionnels, démographiques ou économiques, mais qui est d'une bien autre dimension historique et humaine, et finalement imaginaire!
On ne donne pas sa vie pour l'économie. Mais pour son pays, oui, c'est-à-dire pour des valeurs humaines et un idéal imaginaire, même si je ne peux rien dire de vraiment satisfaisant, ni philosophiquement, ni scientifiquement, ni sociologiquement, ni psychologiquement d'un pays.
Le besoin du réel
Nous sommes ainsi contraints de croire autant à l'imagination qu'à l'objectivité, à la symbolique qu'à la finance, étant nous-mêmes parties prenantes à ces croyances. Il en est de l'astrophysique comme d'un peuple. Une nation, c'est bien plus que des frontières physiques! Est-ce l'action, l'intention, l'emprise politique, la mémoire ou le projet qui donne à un pays sa nature? Sa signification? Notre connaissance de l'univers tient à nos intérêts, à nos préjugés, à nos désirs et à nos peurs, à notre imaginaire, à nos mythes. Il n'en est pas autrement d'un pays.
Fatalité? Impuissance? Logique internationale? Mal imaginaire? Blessure de l'inconscient collectif? Paranoïa? Bien souvent, ce sont les mêmes contraintes du réel, les résistances qu'il nous oppose, les frustrations qu'il nous impose, les évasions, les compensations et les revanches auxquelles nous aspirons, qui excitent le plus activement notre imaginaire et lui donnent finalement plus de puissance que le réel ne saurait par lui-même y prétendre. L'imaginaire a besoin de son contraire pour s'affirmer. Et dans le cas du Québec, c'est certainement la crainte de la perte et l'attachement à une identité menacée qui activent la conscience du pays désiré... [...]
Passer de l'un à l'autre
Un pays, c'est donc toujours, avec ses prétentions de réalité, une chimère dans l'esprit de ses citoyens. «Québec réel et imaginaire? Quelle bonne question! L'un alimente l'autre», déclare Marc A. Vallée en tête de sa réponse. Le Québec rêve de lui-même, bien sûr! Et c'est bien ainsi. Personne ne pourra lui enlever ce songe qui berce ses longues nuits d'hiver.
Pascal Alain le note ainsi: «Depuis le 30 octobre 1995, j'ai vraiment l'impression que le Québec fait du surplace, qu'il tourne en rond, qu'il tend à contaminer sa population avec des questions aux allures de labyrinthes sans sorties. Quand je me rends compte que le Québec tente de m'aspirer dans ces débats stériles, je me réfugie, pour ne pas sombrer dans le vide, dans la lecture, dans l'écriture, dans la musique. Je me réfugie dans mon Québec imaginaire. [...]
Mon Québec imaginaire aura bientôt trois mois et porte le nom de Frida. Quand je constate à quel point les vagues adéquiste et conservatrice déferlent sur le Québec, quand je vois à quel point le PQ se cherche et tourne en rond, quand enfin je sens le vide politique et social m'envelopper, j'ai un lieu de plus pour me réfugier. Je me réfugie dans les yeux de Frida, pour laquelle j'espère une Gaspésie toujours aussi fabuleuse et un Québec qui ne sera plus à vendre au plus offrant.»



