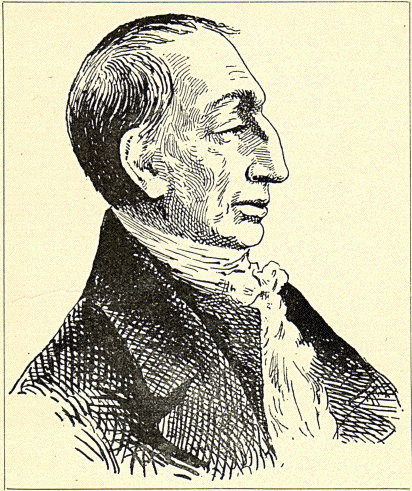II - Le capitalisme catholique conflictuel

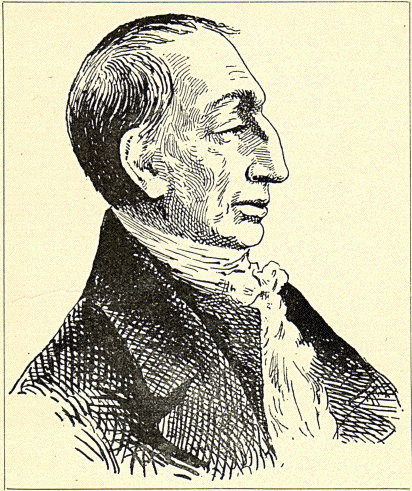

Saint-Simon, Marx et Proudhon
Le capitalisme né de la Réforme a triomphé en Amérique du Nord, alliant la piété à la création de richesse, fondant un consensus social, et devenant lui-même le mythe du nouveau monde. Il en est tout autrement en Europe occidentale, où le travail et l’argent sont des valeurs plus ambiguës. Le mythe biblique condamne Adam au travail en le chassant du paradis terrestre. Et Jésus chasse les marchands du table en affirmant que les pauvres entreront les premiers au paradis. Les privilégiés de l’aristocratie et du haut prélat, qui ont affirmé une légitimité divine de naissance pour thésauriser et vivre somptuairement dans l’oisiveté, prêchent donc la vertu de pauvreté... aux pauvres.
La bourgeoisie, elle, travaille, pour acquérir un statut social, mais elle finit par renverser la royauté trop conservatrice. La Révolution française lui permet d’acquérir à bas prix les biens de l’église et de l’aristocratie qui ont été confisqués. Et elle cherche à son tour à développer un capitalisme industrieux et financier, sous le signe du saint-simonisme. C’est sans compter avec les révoltes du peuple, dessaisi des conquêtes de la Révolution, plus exploité que jamais, et qui trouve ses maîtres à penser avec Proudhon et Marx. En pays catholique, le capitalisme demeure frappé par un profond sentiment originel de culpabilité, comme en témoigne l’influence d’un Lamennais. Freud lui-même identifie l’argent au stade annal du développement de l’enfant (accumulation, rétention, thésaurisation improductive et conflits), qu’il tend à généraliser au capitalisme lui-même. Bref, le capitalisme européen, malgré la compétition du capitalisme de la Réforme qui triomphe en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas et surtout aux États-Unis, demeure profondément divisé en Espagne, au Portugal, en Italie en France. Alors qu’il est identifié au mythe du Nouveau Monde, sous le signe de la liberté, de l’égalité des chances, du bonheur et de la création de richesse en Amérique du Nord, en Europe catholique, le capitalisme est considéré par beaucoup comme destructeur de la société et de la nature. Les mouvements de gauche y voient l’origine de l’inégalité de l’exploitation du prolétariat, de la violence et de la guerre (Thanatos). Il manque de légitimité mythique, il ne se réconcilie pas avec lui-même. Et cette ambiguïté se reflète dans les perpétuelles révoltes populaires, souvent sanglantes, les grèves générales, les conflits sociaux endémiques qui divisent la société depuis lors et jusqu’à nos jours, particulièrement en France. Cela se traduit en Europe par un encadrement de plus en plus étroitement bureaucratique du capitalisme par l’État, à qui on confie la tâche de répartir plus égalitairement la richesse, de protéger les exploités, et finalement de limiter les excès naturels du capitalisme qui aboutiraient à des fractures sociales dangereuses. Cette théorie keynésienne de l’économie, en quête d’équilibre social, triomphe d’ailleurs paradoxalement aujourd’hui aussi aux États-Unis en proie à la pire crise depuis 1929. Le président Obama demande l’intervention massive de l’État en faveur des victimes et des démunis, au grand dam des Républicains ultralibéraux, confiants dans leur tradition, et au risque d’un endettement fatal pour l’avenir du pays.
On le voit bien, le mythe triomphant du capitalisme créateur de richesse, légitimé par la religion réformée, qui a assuré la prospérité américaine, n’a jamais pu s’accommoder des valeurs mythiques de religion catholique, ni en Amérique latine où les espaces à conquérir étaient aussi grands et prometteurs, ni en Europe. Mis en doute perpétuel, soumis à des conflits idéologiques et sociaux incessants, entaché de culpabilité, identifié à la destruction de la société et de la nature, il est remis régulièrement en question et aujourd’hui plus que jamais au vu de la crise américaine. Au moment où beaucoup parlent donc d’une « refondation du capitalisme », nous constatons une fois de plus que le capitalisme n’est pas seulement une administration des affaires et des finances, qui garantirait une compétition équitable : il a partie liée avec nos mythes fondateurs les plus ancrés dans notre civilisation : la religion. Un renforcement de la bureaucratie de la justice de répartition ne suffira sans doute pas à créer une nouvelle dynamique de prospérité. Les vieux mythes semblent décrédibilisés. Il faut imaginer d’autres mythes fondateurs de la vie en société. Penser autrement. Diverger. Inventer un autre opérateur universel de valeur que l’argent. Beaucoup y travaillent, mais c’est la tâche la plus difficile et incertaine qui se puisse concevoir. Seule la démocratie et l’éthique planétaire ont aujourd’hui une puissance mythique suffisamment fondée et partagée et pour nous permettre de nous orienter vers une économie équitable, soumise aux mêmes exigences de démocratie que la politique.
Hervé Fischer